Este post também está disponível em:
![]()
![]()
Jacques-Alain Miller
Introduction
La question du vingtième siècle a été celle du réel dans la mesure même où le discours de la science, singulièrement, s’est emparé du langage, qu’il l’a ravi à la rhétorique, et qu’il a entrepris de mesurer le langage, non pas au vrai, mais au réel*.
Ce qui l’annonce, dès le début du siècle, et comme surgeon de l’entreprise de Frege, c’est la fameuse théorie des descriptions définies de Bertrand Russell (1905) concernant le nom propre et évaluant dans quelle mesure le nom propre serait faire nom à ce qui est vraiment, c’est-à-dire à ce qui est réel.
La réflexion philosophique qui procède de cette tradition a comme cœur la théorie de la référence. Dans quelle mesure le langage peut-il ou non toucher au réel ? Comment se nouent le langage et le réel ? – alors que le langage est puissance de semblant – alors que le langage a le pouvoir de faire exsister des fictions. D’où l’idée qu’il se pourrait qu’au regard du réel le langage soit malade, malade de la rhétorique dont il est gros, et qu’il faudrait le guérir par une thérapeutique appropriée, pour qu’il soit vraiment conforme au réel.
C’est toute l’ambition de Wittgenstein et de ses héritiers que de réaliser une thérapeutique du langage, jusqu’à considérer la philosophie elle-même comme une maladie qui témoigne de l’infection que véhicule le langage comme puissance des fictions. Non pas résoudre les questions philosophiques, mais montrer qu’elles ne se posent pas si on se guérit du langage, si on le met au pas du réel.
C’est ce qui conduit Lacan à passer du Nom-du-Père au Père-du-Nom. Ce n’est pas vaine rhétorique. La nomination – donner des noms aux choses, qui est le biais même par lequel Frege et Russell ont entrepris leur questionnement du langage commun – n’est pas la communication, n’est pas la parlotte. La nomination, c’est la question de savoir comment la parlotte peut se nouer à quelque chose de réel.
Dans notre vocabulaire à nous, c’est la fonction du père qui permet de donner un nom aux choses, c’est- à-dire de passer du symbolique au réel. Ce Nom-du-Père – Lacan l’a dit une fois et Éric Laurent l’a fait passer dans notre usage courant –, on peut s’en passer à condition de s’en servir. S’en passer veut dire que le Nom-du-Père, dérivé du concept de l’œdipe, ce n’est pas du réel.
Le Nom-du-Père est un semblant relatif, en effet, qui se fait prendre pour du réel. Le Nom-du-Père n’est pas de l’ordre de ce qui ne cesse pas de s’écrire. C’est pourquoi Lacan a promu, à la place du Nom-du-Père, le symptôme comme ce qui, dans la dimension propre de la psychanalyse, ne cesse pas de s’écrire, c’est-à-dire comme l’équivalent d’un savoir dans le réel. Quand il y a Nom-du-Père, c’est en tant qu’une espèce de symptôme, rien de plus.
Est-ce une loi, le symptôme ?
Si c’est une loi, c’est une loi particulière à un sujet. Et on peut se demander à quelle condition il est pensable qu’il y ait du symptôme pour un sujet.
Si c’est du réel, c’est un réel très particulier, puisque ce serait du réel pour Un, donc pas pour l’Autre. C’est du réel qui ne peut s’aborder que un par un. C’est de beaucoup de conséquences de le constater. Cela met en question ce qu’il en est du réel pour l’espèce humaine.
S’il y a du symptôme pour chacun de ceux qui parlent, cela veut dire qu’au niveau de l’espèce il y a un savoir qui n’est pas inscrit dans le réel. Au niveau de l’espèce qui parle, il n’est pas inscrit dans le réel un savoir qui concerne la sexualité. Il n’y a pas à ce niveau-là ce qu’on appelle « instinct », qui dirige, de façon invariable et typique pour une espèce, vers le partenaire.
Le désir ne peut pas du tout en tenir lieu, parce que le désir est une question. C’est la perplexité sur la question. La pulsion n’en tient pas davantage lieu, parce qu’elle ne donne aucune assurance quant à cet Autre au niveau du sexuel.
Autrement dit, dans ce qui l’anime d’une compétition, d’une référence avec la science, l’existence du symptôme oblige à modifier le concept que nous avons du savoir dans le réel. S’il y a symptôme, alors il n’y a pas savoir dans le réel concernant la sexualité. S’il y a symptôme comme ce qui ne cesse pas de s’écrire pour un sujet, alors, corrélativement, il y a un savoir qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, un savoir spécial. Ce n’est pas le savoir dans le réel en tant qu’il ne cesse pas de s’écrire. S’il y a symptôme, c’est qu’il doit y avoir, pour l’espèce humaine, un savoir qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. C’est là la démonstration que Lacan essaie de faire sourdre de l’expérience analytique. S’il y a symptôme, alors il n’y a pas rapport sexuel, il y a non-rapport sexuel, il y a une absence de savoir dans le réel concernant la sexualité.
Il est très difficile de démontrer une absence de savoir dans le réel. Qu’est-ce qui nous met, dans l’expérience analytique, devant cette absence de savoir dans le réel ?
Ce dont nous avons l’expérience par la psychanalyse, dans chaque cas qui s’expose dans l’expérience analytique – Lacan nous en fait apercevoir la valeur, et il fallait qu’il le formule pour que cela devienne une évidence –, c’est de la fonction déterminante, dans chaque cas, d’une rencontre, d’un aléa, d’un certain hasard, d’un certain « ce n’était pas écrit ».
Cela s’expose, se met en évidence avec une pureté spéciale dans le récit que peut faire un sujet de la genèse de son homosexualité, ou la mauvaise rencontre, qui est une instance en quelque sorte qui éclate à laquelle le sujet attribue ensuite volontiers son orientation sexuelle, mais aussi bien la rencontre de certains mots qui vont décider pour un sujet d’investissements fondamentaux qui conditionneront ensuite le mode sous lequel il se rapportera à la sexualité. Et puis, toujours, dans tous les cas, la jouissance sexuelle se présente sous les espèces, on le sait, du traumatisme, c’est-à-dire comme non préparée par un savoir, comme non harmonique à ce qui était déjà là.
Autrement dit, la constance propre que nous pouvons repérer dans l’expérience analytique est précisément la contingence. Ce que nous repérons comme une constance, c’est cette variabilité même. Et la variabilité veut dire quelque chose. Elle veut dire qu’il n’y a pas un savoir pré-inscrit dans le réel. Cette contingence décide du mode de jouissance du sujet. C’est en cela qu’elle met en évidence l’absence de savoir dans le réel quand il s’agit de la sexualité et de la jouissance. Elle met en évidence un certain « ce n’est pas écrit ». Cela se rencontre. Dès lors, ce qui fait fonction de réel de référence n’est pas un « ne cesse pas de s’écrire », c’est un « ne cesse pas de ne pas s’écrire », c’est-à-dire exactement le rapport sexuel comme impossible.
Lacan s’est posé la question, sur un mode que j’oserai dire torturé, de savoir dans quelle mesure c’était démontrable. Le réel dont il s’agit là est d’une espèce tout à fait différente du réel de la science. Comment démontrer une absence de savoir ?
Il reste volontiers un peu en retrait de ce terme de démonstration. C’est pourquoi il peut dire : « L’expérience analytique atteste un réel, témoigne d’un réel. » C’est comme si, dans notre champ, la contingence, régulière, que nous rencontrons dans tous les cas, attestait de l’impossible. C’est en quelque sorte une démonstration de l’impossible par la contingence.
J’écrirai ce triangle. L’impossible, le « ne cesse pas de ne pas s’écrire », qui est le propre du non-rapport sexuel que j’abrège NRS. Le nécessaire pour chacun est le « ne cesse pas de s’écrire » du symptôme. Et si nous constatons le fait du symptôme, il nous renvoie dans chaque cas à ce NRS. Le contingent du « cesse de ne pas s’écrire » fait en quelque sorte preuve et apparaît sous ces deux espèces essentielles : la rencontre avec la jouissance et la rencontre avec l’Autre, que nous pouvons abréger sous le terme d’amour.
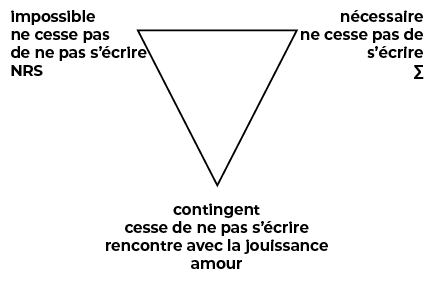 L’amour veut dire que le rapport à l’Autre ne s’établit par aucun instinct dans ce contexte. Il n’est pas direct, mais toujours médié par le symptôme. C’est pourquoi Lacan pouvait définir l’amour par la rencontre, chez le partenaire, des symptômes, des affects, de tout ce qui marque chez lui et chacun la trace de son exil du rapport sexuel.
L’amour veut dire que le rapport à l’Autre ne s’établit par aucun instinct dans ce contexte. Il n’est pas direct, mais toujours médié par le symptôme. C’est pourquoi Lacan pouvait définir l’amour par la rencontre, chez le partenaire, des symptômes, des affects, de tout ce qui marque chez lui et chacun la trace de son exil du rapport sexuel.
Il apparaît que le partenaire fondamental du sujet n’est dans aucun cas l’Autre. Ce n’est pas l’Autre personne, ce n’est pas l’Autre comme lieu de la vérité. Le partenaire du sujet est au contraire, comme cela a toujours été aperçu dans la psychanalyse, quelque chose de lui-même : son image – c’est la théorie du narcissisme, reprise par Lacan dans « Le stade du miroir » – ; son objet petit a, son plus-de-jouir ; et foncièrement sans doute, le symptôme.
Voilà esquissée la théorie du partenaire.
Un complément à la théorie du sujet
Il y a très longtemps, lorsque j’étais philosophe, j’avais extrait de l’enseignement de Lacan ce que j’appelai la théorie du sujet. En rassemblant un certain nombre de considérations sous le chef de « théorie du sujet », j’avais répondu à une invitation de Lacan lui-même, qui avait, à plusieurs reprises, référé le sujet de l’inconscient freudien au cogito cartésien, qu’il avait réécrit, modifié, varié. Cette théorie du sujet était faite pour permettre à cet enseignement de Lacan de communiquer avec les philosophies, en particulier avec la philosophie cartésienne, les philosophies post-cartésiennes, spécialement la philosophie critique de Kant, de Fichte, et la philosophie phénoménologique de Husserl.
Cette perspective, cette tentative, certes datée, n’appelle de ma part aucun reniement, mais un complément. Ce complément à la théorie du sujet, c’est la théorie du partenaire.
Le partenaire-Dieu, biface
Le cogito cartésien « Je pense, donc je suis » a d’ailleurs lui-même un partenaire. Il n’est pas du tout solipsiste. Il a un partenaire au jeu de la vérité. Sans doute ne peut-on pas jouer au jeu de la vérité sans un partenaire.
Quel est ce partenaire ?
C’est d’abord, très simplement, ses propres pensées. Son premier partenaire est son propre « je pense ». Mais dire que c’est son « je pense » serait déjà trop dire, parce qu’il ne peut isoler son « je pense » parmi ses pensées que s’il cesse de se confondre avec ses pensées, s’il cesse de les penser purement et simplement ces pensées qu’il a.
Quand cesse-t-il de se confondre avec les pensées qu’il a ? Quand il s’interroge à propos de ses pensées.
Quand il s’interroge sur ses pensées, évidemment, il s’en distingue. Il s’interroge – quelle idée ! – sur le point de savoir si elles sont vraies, et sur le point de savoir comment savoir si elles sont vraies ou pas. Cela suffit à introduire le ver dans le fruit, le fruit de ses pensées. La question de la vérité introduit le ver – question de la vérité qui n’est pas distincte, chez Descartes, de la question de la référence, puisqu’il s’agit de savoir si la pensée touche ou non au réel, à le traduire dans nos termes à nous.
Aussitôt, la question de la vérité fait surgir l’instance du mensonge sous les espèces d’un Autre qui trompe. Voilà le partenaire qui surgit alors pour Descartes. Un autre imaginaire, sans doute, fictif, l’Autre qui trompe, qui lui met ces idées-là dans la tête. C’est avec cet Autre-là qu’il joue sa partie.
Les Méditations de Descartes, c’est la partie jouée avec l’Autre qui trompe, l’Autre dont les pensées de Descartes ne seraient que les productions illusoires qu’il émet afin de l’égarer.
Cette partie jouée avec l’Autre trompeur paraît d’abord perdante, nécessairement perdante, puisque le sujet concède à cet Autre la toute-puissance – « tu peux tout faire » –, et donc la puissance de le tromper dans toutes ses pensées, même celles qui lui paraissent les plus sûres. La partie est inégale, radicalement inégale. L’Autre trompeur d’emblée le détrousse, ramasse toute la mise, qui sont ses propres pensées que le sujet cartésien met en jeu : qu’est-ce qu’elles valent ? Et l’Autre qu’il a imaginé nettoie la table. Toutes peuvent être trompeuses, toutes peuvent ne rien valoir. Aucune ne porte en elle-même la marque de la vérité. Il ne lui reste rien. « Tout est perdu, for l’honneur », a ajouté un roi de France.
Ce qui fait l’enchantement du conte cartésien, c’est que le sujet trouve le ressort de son triomphe dans cette déroute radicale elle-même. Dans ce renoncement à tout avoir, dans cette pauvreté radicale, dépouillée de tout par l’Autre qui peut tout, précisément là il trouve son être. Il le trouve dans un pur « je pense » sectionné de tout complément d’objet, un « je pense » exactement absolu, au sens propre, au sens étymologique, c’est-à-dire un « je pense » sectionné, coupé.
C’est comme par miracle le point où la pensée et le réel coïncident. Une fois sauvé de l’Autre-qui-peut-tout ce petit rien qui lui reste comme un résidu, tout est gagné. Un nouvel empire est gagné, puisque de fil en aiguille le sujet cogital récupère son authentique partenaire, c’est-à-dire l’Autre qui ne trompe pas, et donc évacue la fiction de l’Autre qui trompe.
C’est tout à fait autre chose de continuer la partie avec un Autre qui ne trompe pas. Tout-puissant sans doute, mais vérace, car la toute-puissance – c’est l’axiome de Descartes – s’amoindrirait par le mensonge. Le mensonge témoignerait toujours d’un moindre être. Tout-puissant, donc fiable. Un partenaire fiable, même s’il est tout-puissant, il est impuissant, il vous fout la paix. C’est ce que Descartes conquiert dans ses Méditations, un Autre qui lui fout une paix royale.
L’avantage du Dieu de Descartes – nous continuons de vivre sur les intérêts de ce qu’il a gagné alors –, c’est qu’on n’a pas à s’en inquiéter. Il ne va pas vous prendre en traître, vous jouer des tours. Il ne va pas vous faire des niches, des surprises. Il ne va pas réclamer des sacrifices. Ce qui est merveilleux, c’est que cet Autre tout-puissant se tient bien tranquille. Il est tout à ce qu’il a posé une fois pour toutes. On peut lui faire confiance, s’occuper des choses sérieuses, il ne va pas vous déranger. Cette chose sérieuse consiste, comme dit Descartes, à se rendre maître et possesseur de la nature. L’Autre là-bas n’a rien à dire là-dessus. D’ailleurs, il n’a rien à dire sur rien. Tout-puissant ! Tout-puissant, au point de ne pas pouvoir mentir. C’est le tour extraordinaire de Descartes. L’Autre est si puissant, il peut tellement tout, qu’il ne peut pas mentir. Cela l’amoindrirait. Ce n’est pas digne de lui. Ce n’est pas conforme à sa définition logique. C’est le silence divin. Ce silence, c’est divin I C’est d’ailleurs ce qui nous permet à part cela de déconner tranquillement parce qu’on attend qu’il vienne ici nous sonner les cloches.
C’est à Descartes que l’on doit le Dieu des philosophes. C’est lui qui l’a mis au monde. Il a été aidé par la théologie qui a fait beaucoup pour museler Dieu, mais cela s’est vraiment accompli avec Descartes. Le Dieu pour la science. Le Dieu déduit, logiquement déduit.
Ce Dieu là, ce partenaire-Dieu, n’a rien à voir avec le Dieu du texte, le Dieu scruté dans le signifiant biblique. Rien à voir, sinon le créationnisme, mais que je laisse de côté. Le Dieu du texte biblique est un Dieu tourmenté, un Dieu menteur et tourmenteur, capricieux et furibard, irrité, et qui joue des tours pas possibles à l’humanité, comme d’inventer de lui déléguer son fils pour savoir ce qu’on va en faire, et comment lui-même tiendra le coup. Pascal ou Kierkegaard, eux, avaient rapport avec le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob, et c’était une tout autre affaire. Avoir ce partenaire-là pour jouer sa partie n’introduit pas du tout à la quiétude, mais plutôt à la crainte et au tremblement.
La différence entre ces deux Dieux partenaires, c’est que celui-ci a du désir et que le Dieu de la science n’en a pas.
Le chapitre 1 de la théorie du partenaire concerne ainsi le partenaire-Dieu, qui est biface.
Le partenaire-psychanalyste désir
Le chapitre 2 pourrait être la psychanalyse dans la mesure où le sujet va y chercher et, on espère, y trouve un partenaire nouveau qui est le psychanalyste.
Le partenaire-psychanalyste ressemble-t-il au partenaire-Dieu science ou au partenaire-Dieu désir ? Il y a les deux.
Par une face, il y a l’analyste-science. On cherche l’analyste patenté, fiable à long terme, pas capricieux, invariable, au moins pas trop remuant. Lacan allait jusqu’à imager ce partenariat en comparant l’analyste au mort dans la partie de bridge, et invitait donc l’analyste à tenir une position cadavérisée, à réduire sa présence à une fonction du jeu, et à tendre à se confondre avec le sujet supposé savoir.
Mais, par une autre face, il y a l’analyste-désir. Même si son silence est divin, sa fonction comporte qu’il parle au moins de temps à autre. Ce que l’on appelle interpréter. Ce qui conduit le sujet à, lui, interpréter les dits de l’analyste. Dès lors que l’analyste parle et qu’on l’interprète, cela met son désir en jeu. Et on n’a pas reculé à faire du désir de l’analyste une fonction de la partie qui se joue dans l’analyse.
Si l’on se pose la question de savoir si l’analyste tient du partenaire-Dieu science ou du partenaire- Dieu désir, on est bien forcé de dire qu’il tient des deux.
Qu’est-ce qui oblige à le mesurer au partenaire divin ? Il est plus raisonnable sans doute de le mesurer au partenaire dans la vie, au partenaire vital.
C’est un fait d’observation courante que l’on a recours au partenaire-analyste lorsqu’on a quelque difficulté avec son partenaire dans la vie. Cela se découvre dans la psychanalyse, parfois dès le début et parfois au cours de l’analyse.
On se plaint de son partenaire vital au partenaire-analyste sous des formes diverses. Cela occupe phénoménologiquement une part considérable du temps des séances. On vient bien souvent trouver le partenaire-analyste pour se demander ce qu’on fait avec son partenaire vital, comment on a pu songer à s’apparier à cette plaie.
On a donc bien souvent recours au partenaire-analyste pour supporter le partenaire vital, par exemple pour le déchiffrer, quand on n’arrive pas à comprendre ce qu’il dit, les signaux qu’il émet, les messages ambigus, équivoques, peut-être malveillants, qui vous sont destinés, comme s’il parlait par énigmes. On vient traiter la question du désir du partenaire auprès du partenaire-analyste. Souvent aussi parce qu’on est blessé par ce que dit le partenaire vital.
En règle générale, une femme n’arrive pas à encaisser ce que dit son homme. Aussi bien, elle n’arrive pas à encaisser ce que dit sa mère. Cela peut s’étendre, et toute règle est susceptible d’exception.
Du côté homme, bien souvent, le problème est de ne pas arriver à choisir son partenaire, de ne pas arriver à être sûr de quel est le bon, si on en a plusieurs, ou que c’est le bon, lorsqu’on en a un.
Lorsqu’on n’en a pas, lorsqu’on pense qu’on n’a pas de partenaire, on se demande pourquoi. Qu’est-ce qui fait obstacle à en avoir un ?
Dans tous les cas, avoir recours à l’analyse, c’est introduire un partenaire supplémentaire dans la partie qui se joue pour le sujet avec un partenaire éventuellement imaginaire.
La clinique, c’est le partenaire
On peut tout de suite aller à dire que ce qu’on appelle la clinique, c’est le partenaire. Dans l’analyse, le partenaire c’est le réel comme impossible à supporter.
Parfois, le vrai partenaire, ce sont les pensées, comme pour Descartes au début. Il se peut que le sujet n’arrive pas à supporter les pensées qui lui viennent et que ce soient elles qui le persécutent. Il joue sa partie avec ses pensées. Comment arriver à ne pas les penser, donc à penser à autre chose ? Puis, il se trouve éventuellement rattrapé par ses pensées. Il s’efforce d’annuler son propre « je pense », par exemple, de l’intoxiquer, de l’anesthésier. Il ruse avec ses pensées. C’est là que se joue sa partie. C’est là aussi, dans une certaine forme clinique, que l’idée de suicide peut lui venir, le suicide étant une façon radicale de divorcer de ses pensées.
Parfois le partenaire essentiel, c’est le corps, le corps qui n’en fait qu’à sa tête. C’est ce que l’on rencontre aussi bien dans l’hystérie de conversion, moins fréquente tout de même de nos jours, moins populaire, ou dans la clinique psychosomatique.
Avoir recours à l’analyse, c’est finalement toujours substituer un couple à un autre, ou au moins superposer un couple à un autre.
D’ailleurs, le conjoint, quand il y en a un, ne prend pas toujours cela très bien. Il s’oppose, il tolère, éventuellement il entre à son tour en analyse. Comme je l’ai déjà mentionné, le conjoint n’est pas toujours la personne à qui vous unissent les liens du mariage, ni non plus la personne avec qui vous partagez le lit, le concubin.
Ce qu’on a appelé l’hystérie féminine, c’est lorsque le partenaire conjoint est le père. On en a fait une catégorie clinique à part. Bien entendu, le partenaire conjoint peut être aussi bien la mère.
Qu’est-ce qu’on a appelé l’obsessionnel ? On a appelé obsessionnel le sujet dont le partenaire est la pensée. On parle, dans le cas de l’homme aux rats, de la dame de ses pensées. C’est bien plutôt ses pensées sur la dame. C’est avec sa pensée, exactement, qu’il jouit.
On appelle paranoïaque celui dont le partenaire, c’est ce que disent les autres et qui le visent en mauvaise part.
Le partenaire a bien des visages. Pour le dire d’un mot qui aurait l’air savant, le partenaire est multifigural. Beaucoup de variétés, de diversités, mais cherchez toujours le partenaire. Ne pas s’hypnotiser sur la position du sujet, sinon poser la question : avec qui joue-t-il sa partie ?
Dans la psychanalyse, le partenaire est une instance avec laquelle le sujet est lié de façon essentielle, une instance qui lui fait problème, c’est-à-dire qui fait énigme à l’occasion.
Les versions lacaniennes du partenaire subjectif
À quoi peut-on isoler le partenaire pris en ce sens ?
Premièrement, le sujet n’arrive pas à le supporter, c’est-à-dire exactement n’arrive pas à l’homéostasier, à le réduire dans l’homéostase qu’il maintient. C’est ce qui est apparu dans la psychanalyse, au départ, comme le traumatisme.
Deuxièmement, le sujet en jouit répétitivement, comme dans l’analyse. Dans la règle, cela se met en évidence. C’est dire que le partenaire a statut de symptôme. Le partenaire-symptôme est sans doute la formule la plus générale pour recouvrir le partenaire multifigural.
On pourrait inscrire là un petit retour sur Lacan, qui s’est en effet posé d’emblée la question de savoir qui est le partenaire fondamental du sujet.
La réponse première qu’il a donnée à partir de 1953, c’est « un autre sujet ». C’est une conception dialectique de la psychanalyse. C’était l’introduction de Hegel dans la psychanalyse. Dans cette notion, il y a symptôme quand l’Autre sujet qui est votre partenaire fondamental ne reconnaît pas votre désir. D’où retour à l’analyste comme le sujet capable de reconnaître les désirs qui n’ont pas été reconnus comme il fallait en leur temps par le partenaire-sujet.
Cette introduction sensationnelle de Hegel dans la psychanalyse, très saugrenue, a été présentée par Lacan comme un retour à Freud.
Était-ce un simple habillage ? Était-ce un simple travestissement ? On ne peut pas dire cela. D’abord parce que Lacan est allé aux textes de Freud. Il a produit une renaissance de la lecture de Freud, voire une première naissance, puisqu’ils n’avaient jamais jusqu’alors été travaillés de cette façon. Mais au-delà, il y avait une nécessité profonde à ce que cette introduction de Hegel dans la psychanalyse se traduise comme un retour à Freud.
Et pourquoi ? La dialectique implique que l’Autre sujet, symétriquement, se fonde lui aussi dans le rapport intersubjectif. Si l’on reconnaissait le patient comme un sujet ayant à se réaliser dans l’opération analytique, son interlocuteur, son partenaire devait être aussi un sujet se réalisant dans la même opération. D’où la nécessité logique de mettre en valeur le sujet Freud, celui qui a fondé la psychanalyse dans l’opération analytique elle-même. Il y avait ainsi une nécessité à ce que cette introduction de Hegel se présente comme un retour au sujet Freud, celui qui a inventé la psychanalyse par la médiation dialectique de ses patients. En dérivation, cela tendait à valoir pour Lacan lui-même en tant que réinventant la psychanalyse sur les pas de Freud.
Dans cette visée initiale, la partie du sujet était conçue comme se jouant toujours avec un autre sujet, voire des autres sujets, selon le moment de son histoire, comme ne voulant pas le reconnaître lui-même comme sujet. Là, l’analyste était à se substituer à l’Autre sujet historique réticent.
Certes, de ce point de départ, Lacan est parti. Il n’y a pas stationné. Mais la problématique du partenaire, elle, demeure comme un fil de toute sa recherche. Elle comporte – c’est ce qui fait le défaut d’une théorie du sujet – que le sujet est incomplet en tant que tel, qu’il nécessite un partenaire. Le tout est de savoir à quel niveau il le nécessite.
Le premier partenaire que Lacan avait inventé, en effet sur la voie de Freud et de son « Introduction au narcissisme », était le partenaire-image. Ce que raconte « Le stade du miroir », c’est que le partenaire essentiel du sujet est son image. Ce, en raison d’une incomplétude organique de naissance dite de prématuration. C’est même exactement le partenaire narcissique.
C’est de là que Lacan a inventé ce partenaire fascinant, parce que non spéculaire, ce partenaire abstrait et essentiel, dont on trouve pourtant la place dans la méditation philosophique : le partenaire symbolique.
Nous avons appris à situer le sujet face à ce double partenaire, le bon et le mauvais, le partenaire du sens et le partenaire du désir. C’est là que nous avons fait nos classes.
La série des partenaires
Je poursuis ma déclinaison des versions lacaniennes du partenaire subjectif.
Le premier de ces partenaires est le partenaire-image et le second, le partenaire-symbole. Une série s’amorce ainsi, dont les termes peuvent être énumérés. Il n’est pas inutile de s’interroger, avant cette énumération, sur le terme de la série. Quel est-il ? Il vaut la peine de le situer d’emblée. Le terme de la série des partenaires est le partenaire-symptôme.
 Jouer sa partie
Jouer sa partie
Qu’est-ce qu’un partenaire ? Au plus simple, c’est celui avec qui l’on joue sa partie.
On peut se référer à l’étymologie avec ce qu’elle comporte d’aléatoire ou de contingent – le contingent étant la marque même du signifiant, lié au signifiant.
Notre mot de partenaire procède de partner, mot anglais importé dans la langue française dans la seconde moitié du dix-huitième siècle – ce siècle si français dans le monde, puisque c’est l’époque où la globalisation était celle de la langue française. C’est déjà pour nous du passé reculé, puisque la nouvelle langue globale procède de l’anglais.
Certes, ce n’est plus l’anglais des Anglais, et même à peine l’anglais des Américains. C’est un anglais qui est une lingua franca, une sorte d’argot anglais universel.
Ce terme anglais de partner est lui-même emprunté à l’ancien français, curieusement à ce terme de parçonier qui signifiait « associé ». Nous pourrions faire du partenaire la traduction du mot d’associé. Le partenaire est aussi bien l’associé avec qui l’on danse que celui avec qui l’on exerce une profession, une discipline, ou avec qui l’on s’exerce à un sport. C’est aussi celui avec qui l’on converse et également celui avec qui l’on baise. On a partie liée avec le partenaire dans « une partie ».
Le mot de partie mériterait lui-même que l’on s’y arrête, qu’on relève ses paradoxes, qui vont jusqu’à ceux de l’objet partiel, comme on dit en psychanalyse, et d’où Lacan a forgé son objet petit a. Le mot de partie désigne l’élément du tout. C’est ce que formule d’emblée le dictionnaire Robert. Il se découvre, dans la suite des définitions, des traductions sémantiques que propose, de façon toujours ambiguë, équivoque, le dictionnaire, que le mot de partie désigne aussi bien le tout lui-même, en tant qu’il comporte des parties prenantes à ce tout. C’est par là que le mot de partie est lié au jeu. Il désigne aussi bien la convention initiale des joueurs – c’est un usage de la langue classique – que la durée même du jeu, « à l’issue de laquelle sont désignés gagnants et perdants », dit le Robert.
Si j’esquisse une théorie du partenaire, c’est pour autant que le sujet lacanien, celui auquel nous nous rapportons, celui auquel nous avons affaire dans la psychanalyse, est essentiellement engagé dans une partie. Il a de façon essentielle, non pas contingente, mais nécessaire, de structure, un partenaire. Le sujet lacanien est impensable sans un partenaire.
Dire cela, c’est rendre compte de ce qu’a d’essentiel pour le sujet ce qu’on appelle, depuis Lacan, l’expérience analytique – qui n’est rien d’autre qu’une partie, une partie qui se joue avec un partenaire. La question est de savoir comment comprendre ce que peut avoir d’essentiel pour un sujet la partie de psychanalyse, au sens où l’on dit « la partie de cartes ». Comment rendre compte de cette valeur que peut prendre la partie de psychanalyse pour un sujet, sinon en posant qu’il existe fondamentalement, et en dehors même de cet engagement, qui peut se faire ou ne pas se faire, une partie psychique qui est inconsciente?
Le sujet comme tel est toujours engagé, qu’il le sache ou pas, dans une partie. Cela suppose que, déjà, existe la psychanalyse, et que, à partir de ce fait, on essaie d’en imaginer les fondements, ce qui conduit à l’hypothèse d’une partie inconsciente.
S’il se joue pour le sujet une partie inconsciente, c’est qu’il est fondamentalement incomplet.
Cette incomplétude du sujet a d’abord été illustrée par Lacan dans le stade du miroir. Pour le dire dans les termes que j’utilise aujourd’hui, le stade du miroir est une partie que le sujet joue avec son image. Si l’on considère cette construction de Lacan sur le fond de l’élaboration psychanalytique, on est conduit à dire que « Le stade du miroir » est la version lacanienne du narcissisme freudien, de ce que Freud a avancé dans son écrit « Introduction au narcissisme ». Le narcissisme freudien semblait propice à fonder une autarcie du sujet. On l’a lu ainsi. Il y a un niveau ou un moment où le sujet n’a besoin de personne, il trouve en lui-même son objet. On a fait du narcissisme freudien l’absence de partie. C’est de là qu’on a soupçonné d’être illusoires les parties que pouvait jouer le sujet au regard du narcissisme. Le stade du miroir inverse cette lecture, puisqu’il introduit l’altérité au sein même de l’identité-à-soi et qu’il définit par là un statut paradoxal de l’image. L’image dont il s’agit dans le stade du miroir est à la fois l’image-de-soi et une image autre.
Cette partie imaginaire du narcissisme, a–a’, Lacan l’a décrite comme une impasse – aussi bien, par exemple, sur le versant hystérique que sur le versant obsessionnel dans la névrose. Le sujet sort de cette partie toujours perdant. Il n’en sort qu’à ses dépens.
De là, Lacan a introduit un autre partenaire que l’image, le partenaire symbolique, dans l’idée que la clinique comme pathologie s’enracine dans les impasses de la partie imaginaire – impasses qui nécessitent l’analyse comme partie symbolique. Cette partie symbolique est supposée, elle, procurer la passe, c’est-à-dire une issue gagnante pour le sujet.
La conversion de l’agalma en palea
Dans la perspective que je prends sur l’élaboration de Lacan à partir des termes que je mets en épingle de la partie et du partenaire, l’analyse devrait être une partie gagnante pour le sujet, le moyen de gagner la partie qu’il perd dans l’imaginaire, et qui fait précisément sa clinique. D’où le paradoxe de la position de l’analyste en tant que partenaire, qui, au sens de Lacan, est supposé jouer la partie symbolique de façon à la perdre. Il ne peut gagner la partie en tant qu’analyste qu’à condition de la perdre et de faire gagner le partenaire-sujet. Et, sans doute, la position de l’analyste comporte une dimension d’abnégation. Ce que Lacan appelle « la formation de l’analyste » s’enracine en ce point-là. C’est apprendre à perdre la partie qu’il joue avec le sujet et que le gain soit le gain du sujet.
Peut-être puis-je évoquer, comme on l’a fait devant moi, une fin d’analyse, dans sa rusticité, sa naïveté, comme dit Lacan, dans sa brutalité, qui met en valeur ce que cela comporte pour le sujet de gain, corrélatif à l’occasion pour l’analyste d’un certain désarroi.
Voilà qu’au bout d’une longue trajectoire analytique, le sujet rêve qu’une chose que l’on ne peut désigner autrement que par le terme de saloperie sort de sa jambe, et d’une couleur noire – la couleur même, disent les associations, qui est celle d’un objet qui figure dans le cabinet de l’analyste. Quelque temps plus tard, voilà le sujet qui énonce, avec crainte et tremblement, qu’« il est un cochon ». De ce fait, il fait tomber sur l’analyste le masque du loup qui s’est en effet repu de ce cochon – lui-même assez actif du point de vue oral – pendant des années. Puis, quelque temps plus tard, ce sujet, jusqu’alors docile, respectueux, admiratif de l’analyste, arrive à lui renvoyer ce trait, cette flèche, qui est déjà la flèche du Parque, celle que l’on envoie en partant : « Vous êtes chiant. » Et c’est la fin. C’est là l’adieu. C’est là le merci : « J’ai mon compte. » Sous ces espèces-là la saloperie noire, le « je suis un cochon » et le « vous êtes chiant. » Cela fait une fin d’analyse tout à fait tenable. Et voilà l’analyse, lieu de la vérité, réduite à son essence de merde. Comment le dire autrement ? Avec pour le sujet le sentiment d’un merveilleux allégement de la recherche de la vérité, qui ne culmine pas dans la vision de l’essence divine. L’élaboration véridique et les sentiments qui l’ont accompagné, tout ça c’est de la merde pour le sujet. C’est une vérité un peu courte, mais cela peut, à mon sens, valablement représenter une fin d’analyse et non pas une interruption.
Dans ces trois temps que j’ai détaillés, on aperçoit une saisissante, une brutale – pour le sujet lui-même – conversion de l’agalma en palea. La formation de l’analyste se situe exactement en ce point d’assumer la conversion de l’agalma en palea, et, au-delà même, de la vouloir, quand bien même le sujet est à ce propos tout à fait encore aveugle, que c’est pour lui même impensable, voire douloureux, quand il y pense.
Le partenaire-symbole
J’ai parlé de l’impasse. Lacan a décrit les structures cliniques comme des impasses, non pas des impasses illusoires, mais des impasses imaginaires au sens où la vérité a structure de fiction. Ce qui voulait dire que ce sont autant de modes de tromperie, autant de modes de mensonge. La passe étant à chercher, toujours, depuis les débuts de son enseignement du côté de ce qui ne tromperait pas. C’est pourquoi il a d’abord cru trouver cette issue du côté du grand Autre, en tant que l’Autre de la bonne foi, celui qui ne trompe pas.
Il a ainsi distingué l’autre image et l’Autre symbole, en posant que l’Autre symbole était par excellence l’Autre qui ne trompe pas. Comme il le formule page 454 des Écrits : « la solution des impasses imaginaires est à chercher du côté de l’Autre, place essentielle à la structure du symbolique, l’Autre garant de la Bonne Foi, nécessairement évoqué par le pacte de la parole. » Je souligne ici le terme de « nécessairement ». Il y avait pour le premier Lacan quelque chose « qui ne cesse pas de s’écrire quand on parle ». C’est la référence à l’Autre qui ne trompe pas.
Qu’est-ce que cela signifie pratiquement dans l’expérience, sinon que, dans les termes mêmes de Lacan (page 458), aux confins de l’analyse, dans la zone qui concerne ce qu’on appelle la fin de l’analyse et qui est aussi bien l’expulsion du sujet hors de son impasse, il s’agit de restituer une chaîne signifiante ? La fin de l’analyse, si l’on oppose le partenaire-image et le partenaire-symbole, est la restitution d’une chaîne signifiante.
À quoi Lacan voyait trois dimensions. Une dimension qui touche au signifié, celle de l’histoire d’une vie vécue comme histoire, et cela suppose donc l’épopée narrée du sujet, la narration continue de son existence – une dimension signifiante, la perception de sa sujétion aux lois du langage – et l’accès à l’intersubjectivité, au je intersubjectif, par où la vérité entre dans le réel. Ces trois dimensions de la chaîne signifiante ultime valent avant tout par l’absence qui éclate, à savoir par l’absence de toute référence au désir et à la jouissance. C’est ce que comporte essentiellement l’idée d’une partie qui est jouée avec le partenaire-symbole. Cette partie et son issue gagnante laissent de côté tout ce qui concerne désir et jouissance.
La phénoménologie de l’expérience analytique va dans cette direction puisqu’on s’y absente de toute jouissance qui serait là assimilable à ce qui s’obtient, d’une façon plus ou moins satisfaisante, avec le partenaire sexuel. La phénoménologie de l’expérience analytique semble mettre en évidence que le partenaire essentiel du sujet, c’est l’Autre du sens. Comme on le dit, enfin on peut parler dans l’expérience analytique. Enfin on peut mettre des mots sur ce dont il s’agit, opportunité que les aléas de l’existence ne faciliteraient pas au sujet. Autrement dit, il semble que l’analyse fonde, par sa méthode, par les moyens qu’elle emploie, un privilège de la sémanticité sur la sexualité, le privilège du sémantique sur le sexuel.
L’opération analytique peut ainsi être définie dans cette perspective comme la substitution à tout partenaire-image du partenaire-symbole. C’est là, si l’on restitue cette dimension, que l’on peut saisir le privilège, retrouvé par Lacan dans un second temps, du phallus freudien comme signifiant.
Tel que je l’introduis, on aperçoit que cela comporte une modification du concept de l’Autre. L’Autre, tel que je l’ai évoqué était l’Autre de la bonne foi, le Dieu des philosophes. Parler du phallus comme signifiant, c’est dégrader cet Autre. C’est dire qu’il y a dans l’Autre quelque chose du désir. D’où Lacan a élaboré le partenaire-symbole comme étant le phallus. C’était arracher le désir à l’imaginaire et l’assigner au partenaire-grand Autre.
Le phallus est un signifiant. Cette novation, qui a fait trembler sur ses bases la pratique analytique, veut dire que l’Autre n’est pas seulement l’Autre du pacte de la parole, mais aussi bien l’Autre du désir.
De ce fait, le partenaire-symbole est plus complexe qu’on ne pouvait le penser. Cela a conduit Lacan à une relecture et à une réécriture de la théorie freudienne de la vie amoureuse où le partenaire-symbole apparaît d’un côté comme partenaire-phallus et de l’autre côté comme partenaire-amour, c’est-à-dire pas seulement comme le partenaire de la bonne foi par rapport aux tromperies imaginaires, mais comme un partenaire complexe qui se présente avec une dialectique diversifiée selon les sexes. C’est ce que comporte le texte qu’il m’est arrivé plusieurs fois de commenter de « La signification du phallus ».
Nous pourrions déjà ajouter à notre énumération le partenaire-phallus et le partenaire-amour et leur mettre leurs petits signifiants phi et A barré.
Le partenaire petit a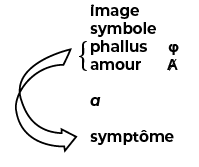
Ajoutons tout de suite le partenaire majeur que Lacan introduit au sujet : le partenaire-petit a, partenaire essentiel révélé par Lacan à partir de la structure du fantasme. Ce n’est pas l’Autre sujet, ni l’image, ni le phallus, mais un objet prélevé sur le corps du sujet.
Lacan a élaboré à partir de là le partenaire essentiel, qui l’a conduit au partenaire-symptôme, qui est, sous diverses figures, le partenaire-jouissance du sujet.
Son texte de « Position de l’inconscient » institue sans doute en face de l’espace du sujet, qui est représenté par un ensemble, le champ de l’Autre. On y retrouve en quelque sorte ce partenariat fondamental du sujet et de l’Autre. Mais ce n’est que pour montrer, dans ce partenariat, que sa racine est l’objet petit a et que le sujet a essentiellement comme partenaire dans l’Autre l’objet petit a. À l’intérieur du champ symbolique, à l’intérieur de la vérité comme fiction, il a affaire, il traite, il s’associe essentiellement dans le fantasme avec l’objet petit a. La substance non seulement de l’image de l’autre, mais bien du grand Autre, est en quelque sorte l’objet petit a
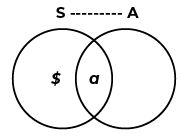
L’enseignement de Lacan n’a fait qu’en dérouler les conséquences à partir de ce mathème, et précisément concernant la sexualité.
Qu’est-ce que la sexualité ? Qu’est-ce que l’Autre sexuel, si le partenaire essentiel du sujet est l’objet petit a, c’est-à-dire quelque chose de sa jouissance ?
Au temps où Lacan nous présentait ce schéma, il pouvait dire que « la sexualité est représentée dans l’inconscient par la pulsion ». Un temps lui était nécessaire avant d’apercevoir que la pulsion ne représente pas la sexualité. Elle ne la représente pas en tant que rapport à l’Autre sexuel. Elle la réduit au contraire au rapport à l’objet petit a.
Il a fallu plusieurs années à Lacan pour admettre les conséquences de cette phrase que je prélève de « Position de l’inconscient » – « la sexualité est représentée dans l’inconscient par la pulsion », en particulier celle-ci : si la sexualité n’est représentée dans l’inconscient que par la pulsion, cela veut dire qu’elle n’est pas représentée. Elle est représentée par autre chose. C’est une représentation non représentative.
Lacan a formulé d’une façon fulgurante la conséquence de cette non-représentation par le non-rapport sexuel. Le non-rapport sexuel veut dire que le partenaire essentiel du sujet est l’objet petit a. C’est quelque chose de sa jouissance à lui, son plus-de-jouir. En cela, son invention de l’objet petit a veut déjà dire qu’il n’y a pas de rapport sexuel.
Le partenaire du sujet n’est pas l’Autre sexuel. Le rapport sexuel n’est pas écrit.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela ne veut pas dire que c’est faux, mais que c’est une formule qui n’est pas dans le réel. C’est absent. Cela donne la raison de la contingence. Cela laisse place à la contingence. Cela démontre la nécessité de la contingence dans ce que l’on pourrait appeler « l’histoire sexuelle du sujet », la narration de ses rencontres. Cela explique qu’il n’y ait que rencontre.
Lacan avait déjà découvert il y a très longtemps la contingence lorsqu’il isolait la fonction du signifiant.
Le signifiant, comme la moindre étymologie le montre, emporte avec lui de l’arbitraire. Nulle part la dérivation du sens des mots que nous utilisons n’est écrite comme nécessaire. Ce sont toujours des rencontres. Chaque mot est une rencontre. L’incidence de chaque mot sur le développement érotique du sujet est marquée de cette contingence. C’est ce que l’on a représenté sous les aspects du traumatisme, qui est toujours une rencontre, et toujours une mauvaise surprise. L’histoire vécue comme histoire, c’est l’histoire des mauvaises surprises qu’on a eues. C’est ainsi que Lacan pouvait dire, page 448 des Écrits, bien avant d’arriver au non-rapport sexuel, mais c’est déjà contenu là : « c’est par la marque d’arbitraire propre à la lettre que s’explique l’extraordinaire contingence des accidents qui donnent à l’inconscient sa véritable figure. »
Une analyse ne fait que mettre en valeur, que détacher cette extraordinaire contingence. On appelle « l’inconscient » les conséquences de l’extraordinaire contingence. La contingence est celle-là même que l’instance du signifiant comme tel imprime dans l’inconscient. Cette contingence est donc intrinsèque au rapport au signifiant.
Il a fallu une dizaine d’années à Lacan pour rendre raison de cette contingence par le non-rapport sexuel. S’il y a cette contingence, c’est qu’il y a corrélativement quelque chose qui n’est pas nécessairement inscrit. Le partenaire, en tant que partenaire sexuel, n’est jamais prescrit, c’est-à-dire programmé. L’Autre sexuel n’existe pas, en ce sens, au regard du plus-de-jouir. Cela veut dire que le partenaire vraiment essentiel est le partenaire de jouissance, le plus-de-jouir même.
D’où l’interrogation sur le choix, chez chacun, de son partenaire sexuel. Eh bien ! Le partenaire sexuel ne séduit jamais que par la façon dont lui-même s’accommode du non-rapport sexuel. On ne séduit jamais que par son symptôme.
C’est pourquoi Lacan pouvait dire, dans son Séminaire Encore, que ce qui provoque l’amour, ce qui permet d’habiller le plus-de-jouir d’une personne, c’est « la rencontre, chez le partenaire, des symptômes et des affects de tout ce qui marque chez chacun la trace de son exil du rapport sexuel ».
C’est une nouvelle doctrine de l’amour. L’amour ne passe pas que par le narcissisme. Il passe par l’existence de l’inconscient. Il suppose que le sujet perçoive chez le partenaire le type de savoir qui, chez lui, répond au non-rapport sexuel. Il suppose la perception, chez le partenaire, du symptôme qu’il a élaboré du fait du non-rapport sexuel. C’est bien dans cette perspective que Lacan a pu poser, dans son Séminaire Encore, que le partenaire du sujet n’est pas l’Autre, mais ce qui vient se substituer à lui sous la forme de la cause du désir. C’est là la conception radicale du partenaire, qui fait de la sexualité un habillage du plus-de-jouir.
L’avantage est que cela rend compte, par exemple, de la toxicomanie. La toxicomanie épouse les lignes de la structure. C’est un anti-amour. La toxicomanie se passe du partenaire sexuel et se concentre, se voue au partenaire (a) – sexué du plus-de-jouir. Elle sacrifie l’imaginaire au réel du plus-de-jouir. Par-là, la toxicomanie est d’époque, de l’époque qui fait primer l’objet petit a sur l’Idéal, de l’époque où grand I vaut moins que petit a.
![]()
Si l’on s’intéresse aujourd’hui à la toxicomanie, qui est de toujours, c’est bien parce qu’elle traduit merveilleusement la solitude de chacun avec son partenaire plus-de-jouir. La toxicomanie est de l’époque du libéralisme, de l’époque où l’on se fout des idéaux, où l’on ne s’occupe pas de construire le grand Autre, où les valeurs idéales de l’Autre national pâlissent, se désagrègent, en face d’une globalisation où personne n’est en charge, une globalisation qui se passe de l’Idéal.
Le symptôme est métaphore du non-rapport sexuel
Qu’est-ce que l’inconscient interprète ? Posons-nous cette question.
L’inconscient interprète précisément le non-rapport sexuel. Et en l’interprétant, il chiffre le non-rapport sexuel, c’est-à-dire que ce chiffrage du non-rapport sexuel est corrélatif du sens qu’il prend pour un sujet. Ce que délivre d’abord le chiffrage du non-rapport sexuel, c’est le symptôme. En cela le symptôme va plus loin que l’inconscient, dans la mesure où il est susceptible de s’incarner dans ce que l’on connaît le mieux, à savoir le partenaire sexuel.
Je fixerai ainsi cette formule point de capiton, essai de problèmes-solutions, qui établit une corrélation entre deux termes du symptôme : ∑ dans la définition développée que Lacan a mise en œuvre dans son dernier enseignement, et le symbole de l’ensemble vide, que j’écris en dessous par commodité, pour abréger ce que Lacan a désigné comme le non-rapport sexuel.
![]() Sans chercher plus loin, j’ai pris le symbole de l’ensemble vide, en infraction certainement à ceci que ce rapport ne peut pas s’écrire dans sa définition lacanienne. Lacan ne l’a jamais écrit, il n’a jamais cherché un mathème du non-rapport sexuel, de façon à exemplifier l’impossibilité de l’écrire. Le mérite de cette formule était de donner un abrégé de ce que j’avais pu développer et d’établir une corrélation entre ces deux termes, le symptôme et le non-rapport sexuel, en l’écrivant sous la forme d’une substitution, d’une métaphore. Le symptôme vient à la place du non-rapport sexuel. Le symptôme est métaphore du non-rapport sexuel.
Sans chercher plus loin, j’ai pris le symbole de l’ensemble vide, en infraction certainement à ceci que ce rapport ne peut pas s’écrire dans sa définition lacanienne. Lacan ne l’a jamais écrit, il n’a jamais cherché un mathème du non-rapport sexuel, de façon à exemplifier l’impossibilité de l’écrire. Le mérite de cette formule était de donner un abrégé de ce que j’avais pu développer et d’établir une corrélation entre ces deux termes, le symptôme et le non-rapport sexuel, en l’écrivant sous la forme d’une substitution, d’une métaphore. Le symptôme vient à la place du non-rapport sexuel. Le symptôme est métaphore du non-rapport sexuel.
La formule se complète de la modalité affectée à chacun de ces deux termes, pour autant que le non- rapport sexuel ne cesse pas de ne pas s’écrire, c’est- à-dire de ne pas venir à la place où, pour des raisons certainement équivoques, nous l’attendrions, tandis que le symptôme ne cesse pas de s’écrire, au moins pour un sujet. Cette formule rappelle ainsi que la nécessité du symptôme répond à l’impossibilité du rapport sexuel. Le non-rapport sexuel est une qualification d’espèce, de l’espèce d’être vivant que l’on appelle l’espèce humaine, et à laquelle, dans cette dimension, on ne peut pas ne pas se référer. Cette formule comporte qu’il n’y a pas d’être relevant de cette espèce qui ne présente de symptôme. Pas d’homme, au sens générique, sans symptôme.
Cette formule fait voir, de façon élémentaire, que le symptôme s’inscrit à la place de ce qui se présente comme un défaut, qui est le défaut de partenaire sexuel « naturel ». Dans l’espèce, le sexe comme tel n’indique pas le partenaire. Il n’indique son partenaire à aucun individu relevant de ladite espèce. Le sexe ne conduit aucun à ce partenaire, et il ne suffit pas, comme le souligne Lacan, à rendre partenaires ceux qui entrent en relation. C’est ce qui permet de définir le mot de partenaire comme ce qui ferait terme du rapport qu’il n’y a pas.
S’il y a rapport, quand s’établit ce qui semble être un rapport, c’est toujours un rapport symptomatique. Dans l’espèce humaine, la nécessité, le «ne cesse pas de s’écrire» s’écrit sous la forme du symptôme. Il n’est pas de rapport susceptible de s’établir entre deux individus de l’espèce qui ne passe par la voie du symptôme.
Plus qu’obstacle, le symptôme est ici médiation. Cela conduit à l’occasion Lacan à identifier le partenaire et le symptôme. On pourrait penser que le partenaire est symptôme quand ce n’est pas le bon. Eh bien, cette construction implique le contraire. Le partenaire symptomatifié, c’est le meilleur, c’est celui avec lequel on est au plus près du rapport.
Ainsi, dans l’expérience analytique, lorsqu’un sujet témoigne de ce qu’il a un partenaire insupportable, qu’il s’en plaint, le b. a.-ba est de poser que ce n’est pas par hasard qu’il s’est apparié à ce partenaire insupportable, et qu’il lui procure le plus-de-jouir qui lui convient. Et c’est à ce niveau du plus-de-jouir, si l’on veut opérer, qu’il faut opérer. Ce sont les cas que j’appellerai d’union symptomatique qui touchent au plus près l’existence du rapport sexuel.
Le concept actuel du symptôme
J’entrerai maintenant plus avant dans le concept actuel du symptôme dans ses rapports doubles avec la pulsion et avec ce que nous appelons, après Lacan, le grand Autre, quasi-mathème qui n’a pas qu’une signification ni qu’un usage.
Je tente là de donner un éclairage nouveau, précis et à certains égards capital à ce à quoi nous nous référons sous le nom chiffré de l’objet petit a.
Un mode-de-jouir sans l’Autre
Je voudrais, dans le fil qui commence à tendre à partir de la dimension autistique du symptôme, évoquer la toxicomanie.
Pourquoi nous y intéressons-nous ? C’est un mode- de-jouir où l’on se passe apparemment de l’autre, qui serait même fait pour que l’on se passe de l’Autre, et où l’on fait seul. Mettons de côté, sans l’oublier, qu’en un certain sens le corps lui-même c’est l’Autre. Je crois que je fais saisir quelque chose si je dis simplement, si je répète, avec d’autres, que c’est un mode-de-jouir où l’on se passe de l’Autre. La jouissance toxicomane est devenue de ce fait comme emblématique de l’autisme contemporain de la jouissance.
J’avais essayé de le résumer par le petit mathème I < a. Qui veut dire quoi ? Grand I est valide, est en plein exercice quand le circuit du mode de jouissance doit passer par l’Autre social et passe de façon évidente par l’Autre social. Alors que, aujourd’hui, comme dit Lacan, notre mode de jouissance ne se situe plus désormais que du plus-de-jouir. Ce qui fait sa précarité, parce qu’il n’est plus solidifié, il n’est plus garanti par la collectivisation du mode-de-jouir. Il est particularisé par le plus-de-jouir. Il n’est plus enchâssé, organisé et solidifié par l’Idéal. Notre mode-de-jouir contemporain est fonctionnellement attiré par son statut autiste.
C’est de là que le problème apparaît d’y faire entrer S de A barré, de forcer le symptôme dans son statut « autistique », de le forcer à se reconnaître comme signifié de l’Autre. Ce n’est pas une opération contre-nature.
Puisque nous parlons des drogues, pensons à l’opium. La jouissance de l’opium est un symptôme que les Anglais, les Impérialistes anglais, les Victoriens, ont proposé sciemment aux Chinois à la belle époque de l’Empire. Il y avait bien sûr une disposition, un petit fond traditionnel de goût de l’opium, mais on leur a proposé systématiquement ce symptôme, qu’ils ont adopté. Ce symptôme a convenu à des finalités de domination, et le Parti communiste chinois, quand il a pris le pouvoir en 1951 – déjà auparavant dans les zones qu’il avait libérées de l’impérialisme – a commencé une éradication politique de ce symptôme.
La fable politique et sa morale
Faisons un excursus et réfléchissons à ce qu’a pu être la domination par le symptôme. Il n’y a pas de meilleure façon de dominer, du point de vue du maître, que d’inspirer, de répandre, de promouvoir un symptôme. Mais cela nous joue des tours.
Lorsque les Castillans ont réduit les Catalans, ils ne leur ont laissé qu’une issue symptomatique qui était de travailler. Les Catalans ont commencé à travailler pendant que les Castillans, les maîtres, eux, ne faisaient rien. Au bout de quelque temps, le travail est évidemment devenu comme une seconde nature pour les Catalans. Maintenant, où ils ne sont plus dominés de la même façon, ils continuent de travailler.
Pensons aussi à ce qui est arrivé aux Tchèques lorsque, à la bataille de la Montagne Blanche, la Bohême a perdu devant les Impériaux. Les Tchèques ont commencé à travailler et continuent… Les Autrichiens, pendant longtemps, ont arrêté. Là, ayant perdu leur empire, ils ont été forcés de s’y remettre en quelque sorte. Je simplifie, bien sûr, une histoire complexe.
On voit le symptôme devenir une seconde nature, au sens où Freud en explique la métapsychologie à propos de la névrose obsessionnelle dans Inhibition, symptôme, angoisse. Il y a un moment où le sujet adopte le symptôme et l’intègre à sa personnalité. Par là même, il cesse de s’en plaindre. C’est ce qui est formidable. Ni les Catalans ni les Tchèques ne se plaignent de travailler. Ce sont plutôt les autres qui se plaignent qu’ils travaillent trop.
Il y a tout de même une leçon, une morale de la fable politique. Notre point de vue spontané sur le symptôme est évidemment de le considérer comme un dysfonctionnement. Nous disons symptôme lorsqu’il y a quelque chose qui cloche. Mais le dysfonctionnement symptomatique ne se repère en fait que par rapport à l’Idéal. Lorsqu’on cesse de le repérer par rapport à l’Idéal, c’est un fonctionnement. Le dysfonctionnement est un fonctionnement. Cela marche comme ça.
Il faut reconnaître que la psychanalyse a fait beaucoup pour la précarité du mode de jouissance contemporain. Elle a en effet fait beaucoup pour que le rapport entre l’Idéal et petit a devienne celui-ci.
Lorsque nous recevons un sujet homosexuel, on voit bien qu’une part de ladite technique analytique consiste non pas du tout à viser l’abandon de l’homosexualité, sauf lorsque c’est possible, lorsque c’est désiré par le sujet. Elle vise essentiellement à obtenir que l’Idéal cesse d’empêcher le sujet de pratiquer son mode de jouissance dans les meilleures conditions, les conditions les plus convenables. L’opération analytique vise bien à soulager le sujet d’un Idéal qui l’opprime à l’occasion et de le mettre en mesure d’entretenir, avec son plus-de-jouir – le plus-de-jouir dont il est capable, le plus-de-jouir qui est le sien –, un rapport plus confortable. La pression de la psychanalyse a certainement contribué à cette inversion sensationnelle et contemporaine des facteurs du mode-de-jouir.
Le maître aussi a des symptômes. C’est la paresse, qui est restée, dans l’histoire, sous l’image magnifique du Grand d’Espagne, pour qui c’était vraiment une déchéance de faire quoi que ce soit. Il était figé dans une paresse divine, qui a d’ailleurs frappé toute l’Europe classique. D’une certaine façon, pas plus noble que l’Espagnol, parce qu’il n’en fiche pas une rame.
Si je continue la psychologie des peuples, c’est tout à fait contraire à ce qu’il y a eu en Angleterre où l’on a eu une aristocratie travailleuse, une aristocratie où ce n’était pas déchoir que de se livrer au travail. Cela lui a valu des résultats sensationnels à une période en tout cas de domination du monde.
En France, c’est plus compliqué à situer. Il y a la période dix-huitième, où on jouait à travailler. Le symbole, c’est Marie-Antoinette et les petits moutons. Ce n’est pas la paresse, c’est l’hommage rendu au travail des masses laborieuses. Cela a changé. L’aristocratie française était tout de même retenue de travailler. Lorsque le Bourgeois gentilhomme se prend pour un gentilhomme et qu’il dit « Oui, le seul ennui c’est que mon père vendait du drap », on lui réplique « Pas du tout, c’était un gentilhomme qui jouait avec ses amis à leur passer du drap ». La noblesse de robe a compliqué le panorama. Mais ce qui a changé fondamentalement les choses, c’est évidemment l’idéologie du service public, la solution sensationnelle qu’a trouvée Napoléon pour mettre au travail aussi l’aristocratie, pour en fabriquer une nouvelle. Il a réussi à obtenir une noblesse qui, non seulement se bat – c’était le symptôme essentiel de la noblesse française –, mais bosse aussi. Il a inventé pour cela des grands concours, les grandes Écoles, la méritocratie française et la production d’une élite de la nation supposée, une aristocratie du mérite en quelque sorte qui fléchit aujourd’hui un petit peu dans son fonctionnement. Le symptôme ne marche plus. L’amour du service public comme symptôme est en train de tomber en désuétude. Même les affaires de corruption, dont on nous enchante tous les jours, témoignent de l’affaissement de l’ancien symptôme qui avait été inculqué par le maître.
Il faudrait dire un mot des USA là-dessus, qui ont l’avantage de ne pas avoir eu de noblesse… Ils ont fini par en avoir une, mais essentiellement une noblesse du pognon. On commence par gagner de l’argent par tous les moyens et, ensuite, on s’ennoblit par la philanthropie. On a à ce moment-là les grands musées américains, les grandes collections, qui viennent toutes de travailleurs enrichis.
Ce petit excursus est fait pour élargir un peu le concept du symptôme. Sans cela, on est à l’étroit dans le symptôme, avec seulement les symptômes de la psychopathologie quotidienne.
Des symptômes à la mode
Il faut distinguer entre les drogues. La jouissance de la marijuana est un symptôme qui ne coupe pas forcément du social. Elle est au contraire souvent considérée comme un adjuvant à la relation sociale, voire à la relation sexuelle. C’est pourquoi le président Clinton ou d’autres peuvent avouer avoir touché à cette jouissance sans en être pour autant déconsidérés. On retrouve là le critère lacanien essentiel de la jouissance toxicomane, qui est vraiment pathologique lorsqu’on la préfère au petit-pipi, c’est-à-dire lorsque, loin d’en être un adjuvant, elle est au contraire préférée à la relation sexuelle, et même que cette jouissance peut avoir un tel prix pour le sujet qu’il la préfère à tout, allant, pour l’obtenir, jusqu’au crime.
Lacan était obligé d’avoir recours aux fictions kantiennes pour expliquer la jouissance perverse. Kant prenait pour acquis ceci : si l’on vous dit à la sortie d’une nuit d’amour avec une dame qu’il y a le gibet, vous y renoncez. Lacan dit qu’on ne reculerait pas forcément, notamment si est là en cause une jouissance qui va au-delà de l’amour de la vie. C’est le critère proprement lacanien de la jouissance toxicomane comme pathologie.
La tolérance que la marijuana reçoit vient du fait qu’elle ne s’inscrit pas du tout dans cette dynamique d’excès, par rapport à quoi on penserait évidemment à opposer l’héroïne qui est au contraire le modèle même qui répond parfaitement au critère lacanien.
Pour s’y retrouver et ne pas parler de la drogue en général, mais toujours particulariser, il faut là opposer héroïne et cocaïne. L’héroïne est sur le versant de la séparation. Elle conduit au statut de déchet, même si ce déchet est stylisé ou valorisé comme il l’est dans les milieux de la mode, où l’on a finalement proposé à l’admiration des foules, pendant des années, des mannequins drogués, dont la posture et l’état physique faisaient allusion à l’héroïne. La cocaïne est-elle sur le versant de l’aliénation. Autant l’héroïne a un effet séparateur par rapport aux signifiants de l’Autre, autant la cocaïne est utilisée comme facilitateur de l’inscription dans la machine tournoyante de l’Autre contemporain.
Je me sers d’aliénation et de séparation – qui sont deux mouvements, deux battements que Lacan a isolés, que vous trouverez dans « Position de l’inconscient » et dans le Séminaire XI – pour ordonner ce qui me semble être les maladies mentales à la mode. Il y a des symptômes à la mode. Ce n’est pas élargir excessivement notre concept du symptôme que d’admettre et de conceptualiser le fait qu’il y a des symptômes à la mode. La dépression, par exemple. Nous critiquons le concept de dépression. Nous considérons qu’il est mal formulé, que c’est différent dans une structure et dans une autre. Commençons d’abord par ne pas avoir de mépris pour le signifiant de dépression. C’est un bon signifiant, parce qu’on s’en sert. C’est un signifiant relativement nouveau. Nous qui nous échinons à produire des signifiants nouveaux, à les espérer, chapeau bas devant un signifiant nouveau qui marche ! C’est un signifiant formidable, la dépression. Sans doute est-il cliniquement ambigu. Mais nous avons peut-être mieux à faire que de jouer les médecins de Molière et de venir avec notre érudition, si justifiée soit-elle, critiquer un signifiant qui dit quelque chose à tout le monde aujourd’hui. Je ne le prends qu’à ce niveau-là. Je n’ai bien sûr rien à dire contre l’investigation clinique qui peut en être faite. Mais il n’est pas anodin qu’aujourd’hui cela dise quelque chose à tout le monde, que ce soit une bonne métaphore, et, à l’occasion, un point fixe, un point de capiton, qui ordonne la plainte d’un sujet.
La dépression elle-même fait couple. Elle est clairement sur le versant de la séparation. C’est une identification au petit a comme déchet, comme reste. Ce sont les phénomènes temporels qui montrent bien la séparation d’avec la chaîne signifiante, et qui peuvent être accentués dans la dépression comme la fermeture définitive de l’horizon temporel. La dépression fait couple avec le stress qui est, lui, un symptôme de l’aliénation. C’est le symptôme qui affecte le sujet qui est entraîné dans le fonctionnement de la chaîne signifiante et dans son accélération. D’où sa liaison avec le symptôme de la cocaïne.
Anorexie et boulimie sont deux autres symptômes à la mode.
L’anorexie est sans aucun doute du côté du sujet barré, du côté de la séparation. C’est la structure de tout désir. C’est le rejet de la mère nourricière et, plus largement, le rejet de l’Autre qui est au premier plan. Tandis que la boulimie met au premier plan la fonction de l’objet, elle est du côté de l’aliénation. Il faut tenir compte de ce que relève Apollinaire et que souligne Lacan : « Celui qui mange n’est jamais seul ». De fait, la boulimie coupe beaucoup moins le sujet des relations sociales que ne le fait l’anorexie poussée à l’extrême.
Dans cette mise en place rapide, j’aurais donc tendance à placer la boulimie du côté de l’aliénation et l’anorexie du côté de la séparation. Mais qu’aperçoit-on dans les deux cas ? C’est foncièrement dans ces symptômes qu’apparaît sa vérité, son équivalence à petit a. Le statut de petit a est mis en évidence aussi bien dans l’anorexie que dans la boulimie.
![]()
Je prenais, par exemple, l’anorexie à la mode, celle des mannequins, et comme modèle physique. Le mannequin anorexique, c’est l’évidence du désir – l’évidence que rien ne peut satisfaire et combler. Il y a une affinité entre le mannequin et l’anorexie : pas de réplétion. La réplétion, c’est la jouissance. L’anorexie est l’évidence du désir et conduit par là même à une phallicisation du corps qui est foncièrement liée à la maigreur. Lacan l’évoque dans « La direction de la cure » quand il prend le rêve de la Belle bouchère qui se conclut finalement par l’analyse du sujet identifié à la tranche de saumon, avec le commentaire « être un phallus, fût-il un peu maigre ». Il y a une affinité entre la maigreur et la féminité phallicisée comme entre la pauvreté et la féminité phallicisée. Je ne le donne pas comme clinique définitive et ne varietur. J’essaye seulement d’animer un peu le paysage. Nous ne sommes pas seulement avec le symptôme obsessionnel bien repéré, cadré, qui affecte l’homme aux rats. Nous ne sommes pas seulement avec le symptôme hystérique. Nous avons un usage du terme symptôme plus étendu et diversifié.
Une économie symptomale
Je vais m’avancer davantage dans le concept du symptôme.
J’ai dû envoyer un petit message à la seconde réunion régionale de l’École du Champ freudien de Caracas qui s’ouvre dans deux jours, et où se retrouvent, avec nos collègues vénézuéliens, les Colombiens, les Équatoriens, les Cubains, les Guatémaltèques, les Péruviens, et aussi des Espagnols de Miami, etc. Je vais vous lire brièvement la partie intéressante et développerai ensuite.
« Il y a, dans le symptôme, ce qui change et ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas est ce qui fait du symptôme un surgeon de la pulsion. En effet, il n’y a pas de nouvelles pulsions. Il y a en revanche de nouveaux symptômes, ceux qui se renouvellent. C’est l’enveloppe formelle du noyau, Kern, de jouissance (l’objet petit a).
« L’Autre dont le symptôme est message comprend le champ de la culture. C’est ce qui fait l’historicité du symptôme. Le symptôme dépend de qui écoute, de qui parle.
« Voyez le Sabbat magistralement décrypté par Karl Grinburg. Voyez l’épidémie contemporaine des personnalités multiples aux États-Unis, étudiée par Yan Hacking et mentionnée par Éric Laurent.
« Il y a des symptômes à la mode et il y a des symptômes qui se démodent. « Il y a des pays exportateurs de symptômes. Aujourd’hui ce sont les États-Unis, le symptôme soviétique ayant disparu. Il y a des pays exportateurs des moyens de satisfaire les symptômes des autres : la Colombie.
« Bref, il y a toute une économie symptomale qui n’a pas encore été conceptualisée. C’est de la clinique, car la clinique n’est pas seulement de la Chose mais de l’Autre. »
J’ai opposé, à la va-vite, une part constante du symptôme et une part variable. La constante du symptôme dans cette optique, c’est l’attache pulsionnelle du symptôme. La variable, c’est son inscription au champ de l’Autre.
Je considère que la bonne orientation concernant le symptôme est de s’orienter sur cette disjonction-là, et en même temps de la travailler.
Quelle est-elle cette disjonction ? C’est une disjonction entre les pulsions d’un côté, et l’Autre sexuel de l’autre côté.
Cette disjonction est justement ce que niait Freud en posant que la pulsion génitale existe. C’était dire qu’il y a une pulsion qui comporte en elle-même le rapport à l’Autre sexuel, qui se satisfait dans le rapport sexuel à l’Autre, donc une communication entre le registre des pulsions et le registre de l’Autre sexuel. C’était d’ailleurs parfois en continuité pour Freud. On commence par se passionner pour le sein de la mère et ensuite c’est la mère qu’on aime. On a une sorte de continuité pulsionnelle. Ce qui permet à Freud, dans certains paragraphes, d’aller à toute vitesse pour nous donner le développement pulsionnel.
C’est là qu’intervient Lacan lorsqu’il formule : « Il n’y a pas de pulsion génitale ». La pulsion génitale est tout de même une fiction freudienne – comme les pulsions d’une façon générale – qui ne marche pas, qui ne correspond pas.
C’est là que s’impose le point de vue selon lequel il y a une disjonction entre pulsion et grand Autre. Cette disjonction met en évidence ce qu’il y a d’autoérotique dans la pulsion elle-même et le statut autoérotique de la pulsion. D’où les pulsions affectent le corps propre et se satisfont dans le corps propre. La satisfaction de la pulsion est la satisfaction du corps propre. C’est notre matérialisme à nous. Le lieu de cette jouissance est le corps de l’Un.
Ce qui fait d’ailleurs toujours problématique le statut de la jouissance de l’Autre et de la jouissance du corps de l’Autre. Parler de la jouissance du corps de l’Autre paraît une métaphore par rapport à ce qui est du réel, à savoir la jouissance du corps de l’Un. On peut toujours ajouter : le corps de l’Un est en fait toujours marqué par l’Autre, il est significantisé, etc. Du point de vue de la jouissance, le lieu propre de la jouissance est tout de même le corps de l’Autre. Et lorsqu’on est vraiment joui par le corps de l’Autre, cela porte un nom clinique précis.
Ce point de vue a un fondement très solide. Cela fonde par exemple Lacan à rappeler que le sexe ne suffit pas à faire des partenaires. Prenons la jouissance phallique comme jouissance de l’organe. On peut bien dire que c’est une jouissance qui n’est pas vraiment du corps de l’Un, qu’elle est hors corps, qu’elle est supplémentaire, etc. Il n’empêche que son lieu n’est pas le corps de l’Autre. Il y a une dimension de la jouissance phallique qui est attachée au corps de l’Un. Et même lorsque Lacan parle de la jouissance féminine, qui n’est pas celle de l’organe où l’altérité est dans le coup, il reste qu’il formule que dans la jouissance, même la jouissance sexuelle, la femme est partenaire de sa solitude, où l’homme ne parvient pas à la rejoindre.
On voit apparaître dans ces formules le chacun-pour-soi pulsionnel et l’horrible solitude de la jouissance qui est spécialement mise en évidence dans la dimension autistique du symptôme. Il y a quelque chose de la jouissance qui coupe du champ de l’Autre. C’est d’ailleurs le fondement même de tout cynisme.
Le symptôme appareille le plus-de-jouir
Qu’est-ce qui se passe du côté du champ de l’Autre ? C’est là que s’organise, disjointe, la relation à l’Autre sexuel, et cette organisation, elle, dépend de la culture, de certaines inventions de la civilisation. Ici la monogamie, assise sur l’adultère, là la polygamie, assise sur la force d’âme, etc. Des inventions de civilisation variables qui connaissent des succès, des décadences. Ce sont des scénarios de la relation sexuelle qui sont disponibles, autant de semblants, qui ne remplacent pas le réel qui fait défaut, celui du rapport sexuel, au sens de Lacan, mais qui leurrent ce rapport. Elles ne remplacent pas ce réel, mais leurrent ce réel. Cela qualifie notre espèce en quelque sorte.
La disjonction entre les pulsions et le grand Autre, c’est le non-rapport sexuel en tant que tel. Cela dit que la pulsion est programmée, tandis que le rapport sexuel ne l’est pas. Le fait de cette disjonction est cohérent avec le fait que cette espèce parle, c’est-à-dire le langage s’établit dans cette béance elle-même. C’est aussi ce qui explique pourquoi la langue que nous parlons est instable, pourquoi elle est toujours en évolution, pourquoi elle est tissée de malentendus. C’est qu’elle ne colle jamais avec le fait sexuel. Elle ne colle jamais avec le fait du non-rapport sexuel. C’est bien sûr ce qui est différent des bactéries qui, elles, communiquent impeccablement. Mais leur communication est de l’ordre du signal, de l’information.
C’est là que nous fascine l’homme neuronal. C’est l’homme-bactérie, l’homme considéré comme une colonie de bactéries où les différentes parties s’envoient des signaux, des informations. Cela marche au mieux. On se comprend. Ce qui est essentiel dans l’homme neuronal, c’est qu’il soit considéré tout seul, tout seul comme bactérie multiple.
Est-ce que l’homme pulsionnel est autistique ? Jusqu’où pouvons-nous pousser la perspective que j’adopte là de l’autisme du symptôme et de l’autoérotisme de la pulsion ?
C’est là que l’on doit constater que cela s’accroche à l’Autre. Même s’il n’y a pas de pulsion génitale, on doit bien supposer une jouissance qui n’est pas autoérotique dans la mesure où incide sur elle ce qui se passe au champ de l’Autre. On ne peut pas se contenter d’une disjonction totale, parce que ce qui se passe au champ de l’Autre incide sur vos convictions de jouissance pulsionnelle. Autrement dit, on ne peut pas se contenter d’un schéma de pure disjonction entre les deux champs, mais il faut une intersection.
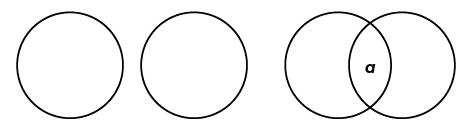 C’est l’intersection même que décrit Lacan en plaçant petit a dans cette zone. Quand nous parlons du désir, de la pulsion, nous le faisons en les accrochant à l’objet perdu. Nous ne pouvons pas utiliser ces concepts sans, d’une façon ou d’une autre, glisser l’objet perdu. Cet objet perdu, il faut aller le chercher chez l’Autre. C’est la double face de l’objet petit a, son caractère janusien. L’objet petit a est à la fois ce qu’il faut à la pulsion en tant qu’autoérotique et aussi ce qu’il faut aller chercher dans l’Autre.
C’est l’intersection même que décrit Lacan en plaçant petit a dans cette zone. Quand nous parlons du désir, de la pulsion, nous le faisons en les accrochant à l’objet perdu. Nous ne pouvons pas utiliser ces concepts sans, d’une façon ou d’une autre, glisser l’objet perdu. Cet objet perdu, il faut aller le chercher chez l’Autre. C’est la double face de l’objet petit a, son caractère janusien. L’objet petit a est à la fois ce qu’il faut à la pulsion en tant qu’autoérotique et aussi ce qu’il faut aller chercher dans l’Autre.
Si l’on ne prend que le petit enfant commençant à parler, c’est tout de même les mots de l’Autre qu’il va prendre et tortiller à sa façon, et ensuite on lui dira que cela ne se dit pas, que cela ne se fait pas, et on régularisera la chose. Les neurosciences sont obligées, pour rendre compte du développement neuronal, de mettre en fonction le regard de l’Autre, parce que ce n’est pas la même chose de recevoir le langage d’une machine ou que ce soit un être humain qui regarde. Il faut qu’il y ait un certain « se faire voir » du sujet pour que cela fonctionne.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’il y a une part de la jouissance de l’Un, cette jouissance autistique, qui est attrapée dans l’Autre, qui est saisie dans la langue et dans la culture. C’est justement parce que cette part est saisie dans l’Autre qu’elle est manipulable. Par exemple, par la publicité, qui est tout de même un art de faire désirer. Ce qui est proposé pour sortir de l’impasse aujourd’hui, c’est la consommation. Ou encore, la culture propose un certain nombre de montages à faire jouir, elle propose des modes-de-jouir qui peuvent être franchement bizarres, et qui n’en sont pas moins sociaux.
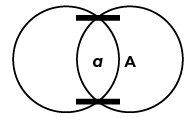
Du côté de l’Autre, il y a en effet comme des mâchoires qui saisissent une partie de cette jouissance autistique ; c’est la signification de la castration. La vérité de la castration est qu’il faut en passer par l’Autre pour jouir et céder de la jouissance à l’Autre.
C’est là que l’Autre vous indique les façons de faire couple. Le mariage monogamique, par exemple. Mais demain il vous indiquera peut-être qu’on peut étendre le concept du mariage jusqu’au mariage homosexuel, ce qui ne fera que révéler le mariage dans son semblant, comme un montage de semblants. On peut dire : ce sera bizarre. Mais il n’y a rien de plus bizarre que la norme. L’esprit des Lumières était justement de s’apercevoir du semblant de la norme et que c’est la norme de sa propre culture qui est bizarre.
Petit a, qu’est-ce que c’est ? C’est cette part de jouissance, ce plus-de-jouir qui est attrapé par les artifices sociaux, dont la langue. Ce sont des artifices qui sont parfois très résistants, et qui peuvent connaître de l’usure aussi bien. Quand le semblant social ne suffit pas, quand les symptômes comme modes-de-jouir que vous offre la culture ne suffisent pas, alors, dans les interstices, il y a place pour les symptômes individuels. Mais les symptômes individuels ne sont pas d’une autre essence que les symptômes sociaux. Ce sont dans tous les cas des appareils pour entourer et situer le plus-de-jouir. Je considère ainsi le symptôme comme ce qui appareille le plus-de-jouir.
Une pulsion toujours active
J’aimerais maintenant éclairer par là ce qui me semble ne pas avoir été vu jusqu’à présent sur la formule même que Lacan a proposée de la pulsion à partir de « se faire ». Il a déchiffré la pulsion dans son Séminaire XI en termes de « se faire voir » pour la pulsion scopique, « se faire entendre », « se faire sucer ou manger », etc. À quoi répond cette formule qui est parfois répétée, mais pas expliquée, et qui n’a pas connu chez Lacan de très grands développements par ailleurs ?
Telles que Freud les décrit, les pulsions répondent à une logique ou à une grammaire : activité/passivité, voir/être vu, battre/être battu. Freud met en place, ordonne, classe, les pulsions selon cette logique qui est du type a-a’, du type symétrique, en miroir. Freud a structuré les pulsions à partir d’une relation d’inversion scopique. C’est une grammaire en miroir et qui a conduit justement à penser que sadisme et masochisme étaient symétriques et inverses, voyeurisme et exhibitionnisme également. C’est ce que Lacan veut corriger pour montrer que le champ pulsionnel répond à une logique tout à fait différente que la logique du miroir. A la place de l’inversion en miroir, il met le mouvement circulaire de la pulsion.
Le mouvement circulaire de la pulsion, qui est dessiné par Lacan dans le Séminaire XI, répond certes à la notion que le corps propre est au début et à la fin du circuit pulsionnel. Les zones érogènes du corps propre sont la source de la pulsion, et le corps propre est aussi le lieu où s’accomplit la satisfaction, le lieu de la jouissance fondamentale, de la jouissance autoérotique de la pulsion.
Qu’est-ce que change le « se faire » que Lacan introduit, et le circuit proprement circulaire ? Ceci que la pulsion est présentée comme étant comme telle toujours active et, contre Freud, que sa forme passive est proprement illusoire. C’est là la véritable valeur du « se faire ». Se faire battre veut dire que l’activité véritable est la mienne et que j’instrumente le battre de l’autre. C’est la position du masochisme fondamental. Autrement dit, Lacan met en relief que la phase passive de la pulsion est en fait toujours la continuation de sa phase active : « Je reçois des coups parce que je le veux. » C’est la formule de Clausewitz : « La passivité est la continuation de l’activité par d’autres moyens ».
Ce qui est capital dans cette dissymétrisation de la pulsion qu’opère Lacan, c’est que l’Autre en question n’est pas le double du moi, mais le grand Autre comme tel. C’est ce qu’il y a d’incroyable dans ce que Lacan dit à ce propos. C’est dans le mouvement circulaire de la pulsion que le sujet vient à atteindre la dimension du grand Autre.
Je ne sais pas si vous saisissez l’énormité de la chose. C’est vraiment établir, fonder en effet le lien, l’intersection entre le champ pulsionnel et le champ de l’Autre. C’est dire que ce n’est pas au niveau du miroir qu’on atteint le grand Autre, mais au niveau même de la pulsion et, bien qu’il n’y ait pas de pulsion génitale, que s’atteint le grand Autre. C’est ce qu’apporte d’essentiel le Séminaire XI : la pulsion qui introduit le grand Autre.
Lacan parle de la pulsion scopique, dans la troisième partie du chapitre XV de ce Séminaire, pour l’étendre aux autres pulsions. La pulsion ainsi considérée est à proprement parler un mouvement d’appel à quelque chose qui est dans l’Autre. C’est ce que Lacan a appelé l’objet petit a. Il l’a appelé l’objet petit a parce qu’il a réduit la libido à la fonction de l’objet perdu. La pulsion cherche quelque chose dans l’Autre et le ramène dans le champ du sujet ou au moins le champ qui devient au terme de ce parcours celui du sujet. La pulsion va chercher l’objet dans l’Autre parce que cet objet en a été séparé.
Lacan le démontre à partir du sein qui n’appartient pas à l’Autre maternel comme tel. C’est le sein du sevrage qui appartenait au corps propre du bébé et il va reprendre son bien. Le sein ou les fèces ne sont pas l’objet petit a au sens de Lacan. Ce ne sont que ses représentants. Il ne faut pas croire que, lorsqu’on met les mains dans la merde, on est vraiment là dans la matière même de l’objet petit a. Pas du tout. La merde aussi est du semblant. Cela veut dire que la satisfaction dont il s’agit est dans la boucle de la pulsion.
Quel est l’exemple que donne Freud, et que Lacan souligne, de la pulsion orale ? Ce n’est pas la bouche qui bave. C’est la bouche qui se baiserait elle-même. C’est même plutôt dans la contraction musculaire de la bouche. C’est un autosuçage. Seulement, pour réaliser l’autobaiser, il faut à la bouche passer par un objet dont la nature est indifférente. C’est pourquoi il y a aussi bien dans la pulsion orale fumer que manger. Ce n’est pas le comestible, la pulsion orale. C’est l’objet qui permet à la bouche de jouir d’elle-même. Et pour cette autojouissance, il faut un hétéro-objet. Autrement dit, l’objet oral n’est que le moyen d’obtenir l’effet d’autosuçage. C’est le paradoxe fondamental de la pulsion. Si je le reconstitue exactement, c’est de sa nature un circuit autoérotique qui ne se boucle que par le moyen de l’objet et de l’Autre. Autrement dit, selon une face, c’est un autoérotisme, selon une autre face, c’est un hétéro-érotisme.
Qu’est-ce, à cet égard, l’objet proprement dit ? L’objet proprement dit, l’objet petit a est un creux, un vide, c’est seulement ce qu’il faut pour que la boucle se ferme. C’est pourquoi Lacan a eu recours à la topologie pour saisir la valeur structurante de l’objet. L’objet petit a n’est pas une substance. C’est un vide topologique. Cet objet peut être représenté, incarné, par des substances et des objets. Mais, quand il est matérialisé, il n’est justement que semblant au regard de ce qu’est l’objet petit a proprement dit. Autrement dit, l’objet réel, ce n’est pas la merde. Et lorsque Lacan dit « l’analyste est un semblant d’objet », eh bien !, la merde aussi est un semblant d’objet petit a, à cet égard. L’analyste représente l’objet petit a et, à ce titre, c’est un semblant, comme l’est toute représentation matérielle de l’objet petit a. Le bébé veut le sein. On lui donne la tétine. C’est aussi bien. Après, il préfère même la tétine. Le sein et la tétine sont du même ordre, au niveau de la pulsion en tout cas, au niveau de ce dont il s’agit, qui est la satisfaction autoérotique de la pulsion.
Je distingue donc, pour faire comprendre, le réel de l’objet petit a qui est le vide topologique et le semblant d’objet petit a qui sont les équivalents, les matérialisations, qui se présentent de cette fonction topologique. On peut d’ailleurs aussi bien dire que les pulsions sont toutes des mythes et que le seul réel, c’est la jouissance neuronale. L’héroïne ou la sublimation ne sont à cet égard que des moyens de la jouissance neuronale. Lorsqu’on prend au sérieux le réel, par rapport au réel, ce sont tous des semblants. Il reste que, y compris au niveau neuronal, cela fait une différence lorsque c’est dit par une machine ou lorsque c’est dit, comme s’expriment les Américains, par un être humain attentif.
Je résume. C’est la pulsion même, dans cette perspective, qui entraîne dans le champ de l’Autre, parce que c’est là que la pulsion trouve les semblants nécessaires à l’entretien de son autoérotisme. Le champ de l’Autre s’étend, jusqu’au champ de la culture, comme espace où s’inventent les semblants, les modes-de-jouir, les modes de satisfaire la pulsion par les semblants. Bien sûr, ces modes sont mobiles. Ce qui introduit un certain relativisme. Au niveau d’un sujet, ils sont bien sûr marqués par une certaine inertie. C’est pourquoi nous admettons d’inscrire le symptôme d’un sujet dans le registre du réel. Le symptôme, social ou « individuel », est un recours pour savoir quoi faire avec l’autre sexe, parce qu’il n’y a pas de formule programmée du rapport entre les sexes.
La pulsion fondement du rapport à l’Autre
J’ai accentué que le symptôme est en deux parts constitué. Premièrement, son noyau de jouissance, celle que nous disons pulsionnelle, qui plonge ses racines dans le corps propre, et, deuxièmement, son enveloppe formelle, par quoi il dépend du champ de l’Autre, lequel comprend la dimension dite de la civilisation. Mais j’ai aussitôt corrigé cette ébauche, pour autant que la pulsion n’accomplit sa boucle de jouissance qu’à passer par l’Autre, pour autant que c’est dans l’Autre que réside ce que nous approchons par l’expression de l’objet perdu. Il faut à la pulsion tourner autour de cet objet, dit Lacan, pour fermer son parcours. La castration est la mise en scène de cette nécessité, où l’objet perdu apparaît comme l’objet pris, l’objet ravi.
Pensons, par exemple, dans la Rome antique, à la course de chars dans le cirque et à la borne qu’il fallait atteindre pour revenir. Ce qui matérialise cette borne est de peu d’importance. Indifférence de l’objet de la pulsion ! Pour que ce parcours, en quelque sorte autoérotique, de la pulsion s’accomplisse, il faut qu’intervienne un objet qui est au champ de l’Autre. Autrement dit, il n’y a pas l’Un disjoint de l’Autre.
Ce schéma implique qu’il y a intersection. Nous connaissons, de façon évidente, cette intersection au niveau du signifiant, où l’Un est le sujet, et où nous avons appris de Lacan à répéter que le signifiant est celui de l’Autre, que nous avons reconnu comme le lieu des codes ou le trésor du signifiant. C’est une intersection, proprement l’intersection signifiante, qui nous est présentée avec évidence dans le fameux graphe de Lacan qui s’est gravé dans les esprits.
L’Autre dont il s’agit n’est d’ailleurs pas seulement celui du signifiant, mais aussi bien celui du signifié. Dans la mesure où ce schéma comporte que l’Autre décide de la vérité du message, par sa ponctuation il décide aussi bien du signifié. C’est pourquoi cette intersection au niveau du signifiant s’est d’abord présentée dans l’enseignement de Lacan comme communication.
La fonction clinique qui a pu être mise là en évidence est celle que Lacan a appelée « le désir » en tant que vecteur qui part de l’Autre. La formule du désir est une incarnation clinique de l’intersection entre l’Un et l’Autre. La seconde intersection, l’intersection libidinale, au niveau de la jouissance, échappe davantage.
Nous avons ânonné l’intersection signifiante à partir du schéma lacanien de la communication. Mais ce qui est plus secret, c’est l’intersection au niveau de la jouissance. Lacan lui-même a opposé le désir et la jouissance en disant « le désir est de l’Autre, mais la jouissance est de la Chose », comme si, en effet, la jouissance était du côté de l’Un et basée sur l’évidence que le lieu de la jouissance est le corps propre.
C’est sur l’intersection de l’Un et de l’Autre au niveau de la jouissance que je porte le projecteur. En quel sens la jouissance est-elle aussi de l’Autre ?
Selon Freud, la libido circule, elle est prise dans ce que l’on peut appeler une communication. Cette invention conceptuelle de Freud qu’est la libido se transvase. La libido a un appareil freudien. Elle est appareillée à des vases communicants. En particulier, la libido freudienne est transfusée de son lieu propre qui serait le narcissisme individuel vers des objets du monde qui se trouvent ainsi investis – objets imaginaires… Cela fait partie de notre vocabulaire et de notre rhétorique la plus naturelle et la plus proche de l’expérience. Investissement de tel objet, désinvestissement, c’est là tout un réseau de communication libidinale.
C’est frappant dans ses conséquences, lorsque Freud nous décrit le phénomène de l’énamoration, c’est-à- dire le moment où se constitue le couple libidinal, au moins du côté de l’un qui tombe amoureux. Le « tomber amoureux » met en évidence le lien établi avec l’Autre. Même si ce n’est que d’un seul côté, c’est en quelque sorte la naissance du couple. Botticelli a peint la naissance de Vénus, toute seule sortant de l’onde. Ce que Freud a peint, c’est le spectateur qui s’énamoure dans l’état amoureux. Freud a traduit ce surgissement de l’amour de l’un pour l’autre en termes d’appauvrissement immédiat de la libido narcissique. La libido se transfuse vers l’objet et le sujet se sent un pauvre gars. Cela semble d’ailleurs être la position de Freud lui-même, ébloui par sa Martha.
C’est en quelque sorte la formule native du couple du point de vue libidinal, et du point de vue de l’amant, qui se trouve aussitôt marqué d’un moins – il s’aime moins –, et au contraire, l’aimé se trouve marqué du signe plus.
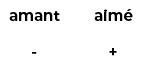 Cette formule si simple est déjà la cellule élémentaire de la formation du couple du point de vue libidinal. Lacan l’a développé comme dialectique du désir. Foncièrement, la position désirante est celle de la femme, en tant qu’elle est marquée de moins, qu’elle n’a pas, alors que, à la surprise générale, c’est l’homme qui est le désirable. C’est ce qui fait de la femme, dans cette perspective, la pauvre comme telle. Cela fait aussi bien du masculin la position passive, tandis que la position féminine est ici active. Elle cherche qui a. D’où l’affinité entre féminité et pauvreté.
Cette formule si simple est déjà la cellule élémentaire de la formation du couple du point de vue libidinal. Lacan l’a développé comme dialectique du désir. Foncièrement, la position désirante est celle de la femme, en tant qu’elle est marquée de moins, qu’elle n’a pas, alors que, à la surprise générale, c’est l’homme qui est le désirable. C’est ce qui fait de la femme, dans cette perspective, la pauvre comme telle. Cela fait aussi bien du masculin la position passive, tandis que la position féminine est ici active. Elle cherche qui a. D’où l’affinité entre féminité et pauvreté.
J’ai souligné jadis la référence que Lacan prenait du livre de Léon Bloy La femme pauvre. C’est la pauvre. La position d’être pauvre foncièrement est la position de l’esclave, qui a d’ailleurs été décernée à la femme plus souvent qu’à son tour au cours de l’histoire.
Ce sont les pauvres qui travaillent et qui aiment en même temps, pas les riches. Les idéaux d’amour universel sont d’ailleurs toujours portés par les pauvres, pas par les riches. Lacan soulignait la difficulté spéciale d’aimer que l’on rencontre chez le riche, et il soulignait aussi bien à d’autres moments, logiquement, la difficulté de s’analyser des riches, parce que, pour s’analyser, la fameuse capacité d’amour joue un rôle.
Il y a un certain nombre de conséquences, que je ne développerai pas dans le détail. L’affinité de la féminité avec l’anorexie trouve ici aussi sa place, et invite aussi bien à situer la boulimie comme une forme dérivée de l’anorexie. Cela indique aussi, deuxièmement, la profonde affinité entre la féminité et la propriété. C’est bien ce moins qui donne à la femme vocation de coffre-fort, conforme à l’imagerie du contenant, qui a souvent été remarquée dans l’expérience analytique. Lacan rappelle la position de la bourgeoise dans le couple, une désignation familière, populaire, ouvrière, de l’épouse. C’est aussi ce qui donne à la femme riche un caractère spécial de dévoration, dans la mesure où rien de l’avoir ne peut étancher sa pauvreté fondamentale. Il n’y a en a jamais assez. Cela montre l’impasse du côté de l’avoir.
On pourrait aussi ajouter, à titre de conséquence, le problème masculin avec la femme riche, plus riche que lui, qui ouvre éventuellement à une protestation virile, pour reprendre le terme d’Adler, ou alors à l’acceptation de sa position de désirable, et éventuellement, chez l’homme, le consentement à son être fétiche de la femme plus riche.
Autre conséquence que je fais apercevoir en passant, conformément à l’axiome de Proudhon, « la propriété, c’est le vol ». Il y a du coup une grande figure de la féminité qui est la voleuse, la voleuse dans son bon droit, puisque le moins, qui marque sa position, donne droit au vol. La clinique semble indiquer que la cleptomanie est une affliction essentiellement féminine. Conséquence concernant l’amour, certainement sur la volonté d’être aimée chez la femme, c’est-à-dire d’obtenir une conversion de son manque fondamental. En effet, aimer une femme, c’est rédimer son manque, racheter sa dette.
On comprend aussi à partir de là que, pour l’homme, à l’occasion, aimer l’autre dans le couple comporte toujours une phase agressive, précisément parce que ça l’appauvrit, parce qu’on ne peut pas aimer sans ce moins que Freud a mis tellement en valeur.
Il y a une solution narcissique qu’indique Freud, qui est de s’aimer soi-même en l’autre, la solution anaclitique étant de mettre en fonction l’autre qui a, mais en tant qu’il donne. Le sujet se présente alors comme l’aimé. Lacan a favorisé, à un moment, la solution narcissique comme étant la position la plus ouverte par rapport à la solution anaclitique, être aimé, qui n’ouvre pas sur le travail, mais sur l’amour.
Peut-être peut-on corriger là certaines des indications antérieures de Lacan par des indications postérieures. Si l’on examine l’amour sous sa face de pulsion, le « être aimé » peut se révéler dans sa valeur de « se faire aimer ». Et pour se faire aimer, il faut à l’occasion en mettre un coup. Si « être aimé » paraît une position passive, « se faire aimer » révèle l’activité sous-jacente à cette position. Il n’empêche que cette formule comporte que la position de désirant est, dans son essence, une position féminine, et que c’est à la condition de rejoindre, d’accepter, d’assumer quelque chose de la féminité que l’homme lui-même est désirant, et donc, d’accepter quelque chose de la castration. Ce qu’on appelle la Sagesse à travers les siècles, et qui est essentiellement masculine, la discipline des Sagesses a toujours consisté à dire : « Écoutez, les gars, faut pas trop désirer ». Et même : « Si vous êtes vraiment parfaits, ne désirez pas du tout ». La Sagesse – les hommes se passent cela à travers les siècles –, c’est de refuser la position désirante, précisément comme féminine. Ce sont d’ailleurs des livres que les femmes n’apprécient pas spécialement.
Ce point de vue freudien comporte qu’au départ la libido est narcissique. Le point de départ de Freud, c’est tout de même la jouissance de l’Un, même si cela ouvre à des transvasements. Ce n’est que secondairement pour Freud que la libido se transvase vers le jouir de l’Autre.
Lacan le critiquait d’emblée, dès les débuts de son enseignement, disant que, lorsqu’on considère que l’objet est primordialement inclus dans la sphère narcissique, on a comme une monade primitive de la jouissance – expression qui figure dans son Séminaire IV. La monade est une unité fermée, séparée de l’Autre. Si l’on part d’une monade de jouissance, une monade de l’Éros, on est obligé d’introduire Thanatos pour rendre compte que l’on puisse aimer autre chose que soi-même. Le choix d’objet, dans cette perspective, est toujours lié à la pulsion de mort. C’est le thème « aimer, c’est mourir un peu ». On sait bien les affinités de l’amour et de la mort dans l’imaginaire.
J’ai déjà ré-évoqué cette position qui va tout de même contre la notion de monade primitive de la jouissance, c’est la notion de l’intersection libidinale fondamentale.
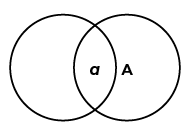 C’est celle qui comporte que, au niveau radical, le champ de l’Autre se réduit à l’objet. À la place de la monade primitive de la jouissance, nous avons sans doute un rapport à l’Autre, mais réduit à un objet nécessaire à la pulsion pour faire son tour. C’est une position où l’Autre n’existe pas, mais où l’objet petit a consiste. C’est la perspective qui est à l’œuvre dans le Séminaire que Lacan a intitulé D’un Autre à l’autre, le grand Autre étant considéré comme un Autre, parce que, là, c’est variable, tandis que l’article singulier est affecté à l’objet. Ce partenaire-là, l’objet petit a, pour vous, c’est toujours le. Il y en a toujours un.
C’est celle qui comporte que, au niveau radical, le champ de l’Autre se réduit à l’objet. À la place de la monade primitive de la jouissance, nous avons sans doute un rapport à l’Autre, mais réduit à un objet nécessaire à la pulsion pour faire son tour. C’est une position où l’Autre n’existe pas, mais où l’objet petit a consiste. C’est la perspective qui est à l’œuvre dans le Séminaire que Lacan a intitulé D’un Autre à l’autre, le grand Autre étant considéré comme un Autre, parce que, là, c’est variable, tandis que l’article singulier est affecté à l’objet. Ce partenaire-là, l’objet petit a, pour vous, c’est toujours le. Il y en a toujours un.
Quel est le partenaire qui va habiller cet objet ? Là, c’est un autre, ou encore un autre. Cela ne mérite pas la même singularité que l’objet. Autrement dit, ce qui complète notre Autre qui n’existe pas, c’est que l’Autre consiste quand il est à l’état d’objet. Ce qui consiste à proprement parler, c’est l’objet pulsionnel, mais en tant que creux, que vide, que pli, ou que bord.
Cela comporte que le fondement du rapport à l’Autre, c’est d’abord la pulsion, la jouissance, l’Autre réduit à la consistance de l’objet petit a comme consistance logico-topologique.
Le partenaire-symptôme
J’ai dit que le sexe ne réussissait pas à rendre les êtres humains, les parlêtres, partenaires. Je développerai qu’à proprement parler seul le symptôme réussit à rendre partenaires les parlêtres. Le vrai fondement du couple, c’est le symptôme. Si l’on considère le mariage comme un contrat légal qui lie des volontés, j’aborderai le couple comme, si je puis dire, un contrat illégal de symptômes.
Sur quoi l’un et l’autre s’accordent-ils, au sens même harmonique ? L’expérience analytique montre que c’est le symptôme de l’un qui entre en consonance avec le symptôme de l’autre.
L’expression « le partenaire-symptôme » n’était pas d’usage jusqu’à présent. Il convient donc de la fonder.
Pour aller au plus court, je rappellerai ce que Lacan a développé de ce que l’on peut appeler le partenaire-phallus, la réduction du partenaire au statut phallique.
Le partenaire-phallus
C’est, dans cette perspective, le sens de sa « Signification du phallus », et précisément de la relecture qu’il y accomplit des textes de Freud sur « La vie amoureuse ».
Lacan distingue et articule trois modalités de couples, trois couples, si l’on exclut de la série le couple du besoin.
Le couple du besoin est fait de celui qui éprouve le besoin, de celui qui est privé, et de l’autre côté, de celui qui a de quoi y répondre. C’est là le degré zéro du couple en tant que fondé sur la dépendance du besoin. Je dis degré zéro dans la mesure où l’on observe déjà ce type de couple dans le règne animal.
On essaie à l’occasion d’en étendre le modèle au couple humain. C’est par exemple la tentative de Bowlby avec son concept de l’attachement.
Suivent les trois couples proprement humains.
D’abord le couple de la demande qui décalque le premier et le transpose dans l’ordre symbolique, puisque c’est là le commutateur lacanien qui permet de passer d’un niveau à l’autre, dans la mesure où le besoin s’articule dans la demande. Le couple de la demande lie entre eux celui qui demande et celui qui répond, dont la réponse consiste à donner ce qui est demandé. Ce couple de la demande est déjà un couple signifiant puisqu’il suppose en effet qu’il y ait l’émission d’un signifiant doté d’un signifié ou qui réveille une signification, et le don a valeur de réponse. En même temps, si l’on suit cette décomposition conceptuelle du couple, ce qui s’y véhicule, ce qui attache l’un à l’autre reste un objet matériel.
Un cran supplémentaire et nous sommes au niveau du couple de l’amour, où il y a aussi celui qui demande et celui qui répond, sauf que celui qui demande ne demande rien de plus que la réponse. S’évanouit à ce niveau la matérialité de l’objet qui circulait dans le couple précédent. Il n’y a pas demande de l’objet et réponse par le don de l’objet, mais purement demande de la réponse comme telle, et le don n’est rien d’autre que le don de la réponse, c’est-à-dire un don signifiant. Le couple de l’amour est à cet égard de part en part un couple signifiant.
Si l’on veut ici resituer les articulations antérieures de Lacan, c’est à ce niveau-là du couple de l’amour qu’il faudrait situer le désir de reconnaissance, qui n’a pas d’autre satisfaction que signifiante. Le désir de reconnaissance s’accomplit, se satisfait, comme son nom l’indique, par une reconnaissance signifiante venue de l’Autre, par un don signifiant, le don d’aucun avoir matériel.
D’où la définition de Lacan de l’amour comme « donner ce qu’on n’a pas », ce qui suppose que, paradoxalement, la demande d’amour de l’un s’adresse au « n’avoir pas » de l’autre. La demande « aime-moi » ne s’adresse à rien de ce que l’autre pourrait avoir. Elle s’adresse à l’autre dans son dénuement et requiert de l’autre d’assumer ce dénuement.
Troisième couple, le couple du désir, qui ne se forme, ne se constitue qu’à la condition que chacun soit pour l’autre cause du désir.
C’est là que s’introduit une tension, une opposition, une dialectique entre le couple de l’amour et le couple du désir, celle-là même que développe Lacan. Ces deux modalités du couple introduisent en effet une double définition du partenaire qui est paradoxale, voire inconsistante. Il y a le partenaire à qui s’adresse la demande d’amour, à qui s’adresse le « aime-moi ». Celui-là, dans ce statut-là, c’est le partenaire dépourvu, le partenaire qui n’a pas. La demande d’amour s’adresse, dans le partenaire, à ce qui lui manque. Ce statut du partenaire est distinct de celui qui est requis du partenaire qui cause le désir, le partenaire qui doit détenir cette cause. S’oppose ainsi ce double statut du partenaire dépourvu et du partenaire pourvu.
Ce paradoxe est au bénéfice de l’homme. L’homme, le mâle, est doté, si je puis dire, d’un objet à éclipse. Selon le moment, il est pourvu ou il est dépourvu. Il satisfait, lui, d’une certaine façon, à ce paradoxe. Vous avez les deux en un. D’où le grand intérêt qui s’attache régulièrement, dans le rapport de couple, à ce qui se passe après, une fois qu’il est dépourvu. La question est de savoir s’il reste ou s’il s’en va. S’il reste, c’est la preuve d’amour. Il y a autre chose que la satisfaction phallique qui le retient.
C’est une grande question, qui a agité les théoriciens par exemple dans la fiction de Rousseau, son Discours sur l’inégalité entre les hommes – de savoir si l’homme reste auprès d’une femme pour en faire sa compagne – on a déjà là le nucleus de l’ordre social à partir de la famille – ou si, ayant tiré son coup, il s’en va. C’est moi qui traduit ainsi ce que dit Rousseau.
Le désavantage de la femme est de n’avoir pas ce merveilleux organe à éclipse. C’est, dans l’articulation que propose Lacan, ce qui pousse l’homme à dédoubler sa partenaire, entre la femme partenaire de l’amour et la femme partenaire du désir.
Le tour de force de cette « Signification du phallus » est de chiffrer à la fois le partenaire de l’amour et le partenaire du désir par le phallus et de définir essentiellement le partenaire du couple comme le partenaire-phallus. S’il est partenaire de l’amour, il est chiffré (-![]() ), une négation portant sur le signifiant imaginaire du phallus. S’il est le partenaire du désir, il est chiffré (
), une négation portant sur le signifiant imaginaire du phallus. S’il est le partenaire du désir, il est chiffré (![]() ) Du côté mâle, une oscillation est possible entre (-
) Du côté mâle, une oscillation est possible entre (-![]() ) et (
) et (![]() ) tandis que du côté du partenaire féminin, c’est ou l’un ou l’autre, ou cela tend à être ou l’un ou l’autre.
) tandis que du côté du partenaire féminin, c’est ou l’un ou l’autre, ou cela tend à être ou l’un ou l’autre.
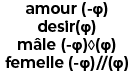
D’un côté une oscillation, et de l’autre une assignation phallique unilatérale. Cela se prête ensuite à toutes les applications particulières, les variations, les détournements de ces formules, mais cela constitue la formule de base du partenariat phallique.
Ce qui rend les sujets partenaires
C’est ici que s’inscrit la relation sexuelle dans sa différence avec le rapport sexuel. La relation sexuelle proprement dite est un lien qui s’établit au niveau du désir, qui suppose donc que le partenaire ait une signification phallique positive. Dans ce lien, le médiateur c’est la signification du phallus. Il y a la relation sexuelle, qui elle s’établit sous le signifiant du phallus, qui fait de chaque partenaire la cause du désir de l’Autre. Ils sont, à ce niveau, rendus partenaires par la copule phallique. Le rapport sexuel, dans sa différence avec la relation sexuelle, c’est le lien qui s’établirait au niveau de la jouissance. C’est bien ce qui est interrogé, de savoir ce qui établirait un lien de partenaire au niveau de la jouissance.
Qu’est-ce qui rend les sujets partenaires ? Ils sont rendus d’abord partenaires par la parole, ne serait-ce que parce qu’ils s’adressent à l’Autre et que l’Autre leur répond, les reconnaît ou pas, les identifie. Le fondement du couple signifiant, c’est un « tu es », « tu es ceci ». Lacan faisait en effet du signifiant, à un moment, le fondement idéal du couple.
Dans Freud, les sujets sont rendus partenaires essentiellement par l’identification au même. L’identification, c’est le noyau du couple signifiant.
Sauf que ce couple peut s’étendre par là jusqu’à embrasser une collectivité. Les sujets sont aussi bien rendus partenaires par la libido dans Freud. Ce que Lacan traduit dans un premier temps par le couple imaginaire a-a’, avec une libido circulant entre ces deux termes. Et il est devenu classique d’opposer, avec lui, le couple signifiant symbolique et ce couple imaginaire, lui, plus douteux, plus instable, parce que lié aux avatars de la libido.
On peut ajouter que les sujets sont rendus partenaires par le désir, le désir qui est la traduction lacanienne de la libido, et précisément partenaires par la médiation du phallus. Le phallus est une instance en quelque sorte biface entre parole et libido, puisque Lacan en fait, au sommet de son élaboration de ce terme, le signifiant de la jouissance. Signifiant de la jouissance, c’est déjà lier, en une expression, la parole et la libido.
Mais ces différents modes de partenariat, par la parole, par la libido, par le désir, cela ne résout pas la question de savoir si les sujets sont rendus partenaires par la jouissance. On est plutôt porté à penser qu’ils sont rendus solitaires par la jouissance. C’est le statut autoérotique, voire autistique de la jouissance.
Même si l’on considère séparément les sujets de chaque sexe, la femme s’en va ailleurs, toute seule, tandis que l’homme est la proie de la jouissance d’un organe prélevé sur son corps propre, et qui, si l’on veut, lui fait une compagnie. La jouissance, à la différence de la parole, rend solitaire.
Il y cet espoir, qu’on appelle la castration. C’est l’espoir qu’une part de cette jouissance autistique soit perdue, et qu’elle se retrouve, sous forme d’objet perdu, dans l’Autre. La castration, c’est l’espoir que la jouissance rend partenaire, parce qu’elle obligerait à trouver le complément de jouissance qu’il faut dans l’Autre.
Le thème du partenaire-phallus, chez Lacan, traduit la face positive de la castration. La castration, c’est le sexe rendant partenaires les sujets. Seulement, sous un autre angle, cela ne fait de l’Autre qu’un moyen de jouissance. Et il n’est pas évident que cela surclasse, que cela annule le chacun-pour-soi de la jouissance et son idiotie.
Lacan évoque, dans le Séminaire Encore, la masturbation comme jouissance de l’idiot. Disons que l’idiotie de la jouissance n’est évidemment pas surclassée par la fiction consolante de la castration.
C’est bien la différence qui déjà se marque si l’on oppose la construction de Lacan dans sa « Signification du phallus » et celle à laquelle il procède dans son « Étourdit ». Dans « La signification du phallus », on a affaire au partenaire phallicisé, à la tentative de démontrer en quoi le phallus rend partenaire. On retrouve ce phallus dans la construction de « L’étourdit », mais elle ne porte pas sur le partenaire, elle porte sur le sujet lui-même, inscrit dans la fonction phallique. A ce niveau, loin d’ouvrir sur le partenaire, loin de qualifier le partenaire, la fonction phallique qualifie le sujet lui-même, et elle le montre partenaire de la fonction phallique. C’est ainsi qu’entre les lignes on peut lire qu’ils ne sont pas partenaires par ce biais-là. L’un et l’autre ne sont pas partenaires par le biais de la fonction phallique, qui qualifie au contraire le rapport du sujet lui-même à cette fonction. Et par là, le partenaire n’apparaît que dans ce statut minoré, dégradé, qui est celui d’être moyen de jouissance.
A vrai dire, le partenaire moyen de jouissance, c’est déjà ce qui apparaît dans le fantasme. La théorie du fantasme comporte que le partenaire essentiel est le partenaire fantasmatique, celui qui est écrit par Lacan à la place de petit a dans la formule du fantasme. Le statut essentiel du partenaire au niveau de la jouissance, c’est d’être l’objet petit a du fantasme.
Certes, lorsque Lacan forge cette formule à partir d’ « Un enfant est battu » de Freud, ce petit a est un terme imaginaire, et sans doute distingue-t-il l’enveloppe formelle du fantasme, à savoir ce qui est image et ce qui est phrase dans le fantasme, de son noyau de jouissance qui est à proprement parler le « se faire battre ». Dans ce contexte, le fantasme s’oppose au symptôme, et d’abord parce que le fantasme est jouissance plaisante, alors que le symptôme est douleur. C’est là que Lacan insiste sur le statut de message du symptôme, son statut donc de vérité, tout en prévoyant, dans son graphe, une incidence du fantasme sur le symptôme.
Seulement, symptôme et fantasme, si essentiels à distinguer, se retrouvent, se conjoignent au terme de l’enseignement de Lacan, d’abord parce que, si l’on prend le fantasme dans son statut fondamental, il n’est plus l’imaginaire ou le symbolique, mais vraiment le réel de la jouissance. Et il se conjoint par là au symptôme dans la mesure où il n’est pas que message, mais jouissance aussi.
Ce qui apparaît donc fondamental, aussi bien dans le fantasme que dans le symptôme, c’est le noyau de jouissance, dont l’un et l’autre sont comme des modalités, des enveloppes. Le modèle du symptôme dont il s’agit là n’est pas tant le modèle hystérique du symptôme, qui a fasciné Freud, d’abord parce qu’il était déchiffrable, mais proprement le symptôme obsessionnel tel que Freud en souligne le statut dans Inhibition, symptôme et angoisse, le symptôme obsessionnel que le moi adopte, qui fait partie de la personnalité, et qui, loin de se détacher, devient source de satisfaction plaisante, sans discordance.
Nous sommes au niveau où le sujet est heureux. Il est heureux dans le fantasme comme dans le symptôme. C’est dans cette perspective-là que je parle du partenaire-symptôme. Le partenaire est susceptible, s’il est lié au sujet de façon essentielle, d’incarner à proprement parler le symptôme du sujet.
Fondement symptomatique du couple
Peut-être faut-il donner là quelque exemple où il apparaît que le vrai fondement du couple est, à proprement parler, symptomatique.
Une femme, laissée tomber par le père – figure sublime ! – à la naissance, et même avant la naissance, puisqu’on est dans le cas où le gars prend la poudre d’escampette à peine tiré le fameux coup.
Elle ne devient pas psychotique, en raison d’une substitution qui s’accomplit et qui lui permet de s’arranger avec le signifiant et le signifié. Quelqu’un tient lieu de père, mais pas au point qu’elle ne décide précocement : « Personne ne payera pour moi ». Elle le décide, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, c’est-à-dire assumant la déréliction où elle est primordialement laissée.- « Besoin de personne ! » Voilà comment elle s’en tire.
Cela la lance dans une certaine errance. L’image me venait même de la tortue qui promène sa maison sur son dos.
Elle trouve un homme. Elle s’attache à un homme. Elle fait couple et progéniture avec lui.
Et quel homme trouve-t-elle ? Elle trouve un homme, précisément, qui ne veut pas payer pour une femme. Cela lui convient, évidemment, cet homme qui ne veut pas payer son écot à la femme. Et, entre tous, c’est celui-là avec qui elle fait couple.
C’est un homosexuel. Nobody is perfect. Ils s’aiment, ils s’accordent. Et la base du couple, c’est cela : l’un ne payera pas pour l’autre.
Le malheur veut tout de même qu’elle entre en analyse. On sait que – pas de hasard – l’analyse est volontiers cause de divorce. Et, dans l’analyse, naît le désir que l’Autre paye pour elle.
Un rêve revient : une boutique de son enfance, qui ramène l’association que, lorsqu’elle allait prendre quelque marchandise chez le fournisseur, en bas de chez elle, elle disait : « Papa payera ». Papa, c’était le substitut.
Et la voilà qui se met à désirer que l’homme, le père de ses enfants, paye pour lui. Elle ne veut plus être tortue.
Le gars, fidèle au contrat symptomatique de départ, n’entend pas les lâcher. Et voilà qu’elle le déteste, qu’elle songe à le quitter, qu’elle prépare son départ. Le gars ne moufte pas. Le coffre est fermé. Et voilà que, logiquement, elle lui présente des factures. Et un jour, elle lui présente une facture de trop – de gaz et électricité. Et voilà que cela se révèle intolérable pour lui, qui prend ses cliques et ses claques, vingt ans après, et réclame, enragé, le divorce, après avoir prévenu Gaz de France de ne plus lui envoyer de factures, qu’il ne les payerait plus. Ce divorce est douloureux pour elle, qui découvre qu’elle ne voulait pas ça – alors qu’elle le mijotait depuis quelques années –, qu’elle voulait au contraire un vrai couple, dans son concept.
On peut dire que l’analyse a atteint là la base symptomatique du couple. Et pourquoi ne pas considérer cela comme une traversée du fantasme, du fantasme « besoin de personne ». On constate, en tout cas, que ce fantasme est passé dans sa vie. L’ayant traversé, divorcée, elle se retrouve dans la situation où, certainement, il ne payera plus pour elle. A ce moment si douloureux où se fracture le couple, se découvre ce qui était sa base, que chacun était marié avec son symptôme.
Il faut certainement tenir compte de la dissymétrie de chaque sexe dans son rapport à l’Autre. C’est là que Lacan nous sert de guide. Qu’est-ce que le sujet mâle cherche dans le champ de l’Autre ? Il cherche essentiellement ce qui est l’objet petit a, l’objet qui répond aussi bien à la structure du fantasme. Il n’a rapport qu’avec ce petit a. Cela peut prendre la forme grossière que j’évoquai sous les espèces de « tirer son coup ».
Ce n’est pas foncièrement différent du côté femme. J’écris ici S barré. Lacan met au bout de la flèche un grand F, reste de son élaboration de « La signification du phallus ». Il met grand I plutôt que le phallus imaginaire pour indiquer qu’il y a des objets qui peuvent prendre cette valeur-là. Le phallus est certes le plus chéri, mais l’enfant peut prendre valeur phallique. On peut même à l’occasion entrer en rapport avec l’Autre sexe pour le lui voler, cet enfant à valeur phallique. Mais ce n’est pas foncièrement différent à ce niveau-là en ce que chacun dégrade l’Autre. Chacun vise l’Autre pour en extraire son plus-de-jouir à soi. C’est là que Lacan ajoute un élément du côté femme en plus, dans son champ propre, le sujet féminin a rapport avec ce qu’il écrit S de A barré. C’est là la différence. Le sujet femme a rapport au manque de l’Autre. D’où un affolement spécial.
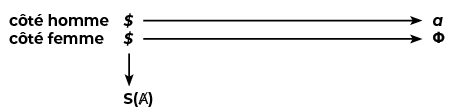 Cela peut se traduire par diverses pantomimes. D’abord celle de faire la folle. C’est toujours ouvert de ce côté-là. C’est par exemple le symptôme de personnalités multiples. Moins sophistiqué, le trouble de l’identité est à inscrire également dans ce registre, et tous les troubles affectant la présence au monde jusqu’aux phénomènes de type oniroïde qui ont été, de longtemps, repérés dans l’hystérie. Mais, autre pantomime que l’on écrira en série : faire de l’homme un dieu. Ou bien le rendre fou. Le sujet féminin va vers l’Autre pour y trouver la consistance, mais offre à l’occasion au sujet mâle de rencontrer l’inconsistance, celle qu’inscrit pas mal grand A barré.
Cela peut se traduire par diverses pantomimes. D’abord celle de faire la folle. C’est toujours ouvert de ce côté-là. C’est par exemple le symptôme de personnalités multiples. Moins sophistiqué, le trouble de l’identité est à inscrire également dans ce registre, et tous les troubles affectant la présence au monde jusqu’aux phénomènes de type oniroïde qui ont été, de longtemps, repérés dans l’hystérie. Mais, autre pantomime que l’on écrira en série : faire de l’homme un dieu. Ou bien le rendre fou. Le sujet féminin va vers l’Autre pour y trouver la consistance, mais offre à l’occasion au sujet mâle de rencontrer l’inconsistance, celle qu’inscrit pas mal grand A barré.
C’est d’ailleurs ce que le malheureux, dont j’ai évoqué le destin, rencontre. Ce qui motive son divorce et qui l’enrage, c’est que finalement elle ne joue pas le jeu. C’est aussi de ce côté-là que s’inscrit la possibilité, pour le sujet féminin, de se faire l’Autre de l’homme, à savoir de se vouer à être son surmoi, dans ses deux faces : de sanction, mais aussi bien de pousse-au-travail, voire de pousse-à-la-jouissance. Freud le signale quand il affecte la femme de ce privilège qu’elle donnerait aux intérêts érotiques. Le sujet féminin est propre à incarner l’impératif « Jouis », aussi bien que celui de « Travaille et ramène de quoi faire bouillir la marmite ». L’impératif est d’ailleurs à l’occasion : « Jouis, mais ne jouis que de moi ». D’où la passion d’être l’unique. L’homme peut aussi bien se loger pour une femme à cette place S de A barré. C’est là que la dissymétrie est la plus probante.
Si l’on suit Lacan, la femme est toujours petit a pour un homme. C’est pourquoi elle n’est pas plus que partenaire-symptôme. Le noyau de jouissance, c’est petit a, et le partenaire est ici l’enveloppe de petit a, exactement comme l’est le symptôme. Le partenaire, comme personne, est l’enveloppe formelle du noyau de jouissance, tandis que, pour la femme, si l’homme se loge en S de A barré, il n’est pas seulement un symptôme circonscrit, parce que cette place comporte l’illimitation. C’est une place qui n’est pas cernée, une place où il n’y a pas de limite. L’homme est alors, lui, partenaire-ravage. Le ravage comporte l’illimitation du symptôme. En un sens, pour chaque sexe, le partenaire est le partenaire-symptôme, mais, plus spécialement, chez la femme, un homme peut avoir fonction de partenaire-ravage.
Partenaire-ravage
Peut-être puis-je en donner un exemple. Une jeune femme mariée avec un homme, qu’elle a décroché.
Lacan parle quelque part des gars en bande qui se bousculent, s’envoient des bourrades. Des filles tournent autour, et une finit par en arracher un à sa bande de copains. Il leur dit : « Au revoir, on ne s’oublie pas. » Hop ! Elle l’emmène.
Elle a surmonté les réticences du gars, ses inhibitions, son extrême mauvaise volonté. Lui voulait rester marié avec sa pensée, ses mauvaises pensées. Elle a exercé un certain forçage pour avoir celui-là, pas un autre, alors que c’est une femme qui ne manquait pas de prétendants.
Le résultat est qu’il ne se passe pas un jour où il ne lui fasse payer l’établissement de ce couple sous la forme de remarques désobligeantes. Classique ! C’est signalé par Freud : l’homme méprise la femme en raison de la castration féminine. Des remarques désobligeantes qui vont jusqu’à l’injure quotidienne, sous des formes particulièrement crues. La haine de la féminité s’expose de la façon la plus évidente.
On s’ameute, les amis disent : « Quitte-le donc ! » C’est la fameuse question « qu’est-ce qu’elle lui trouve ? », qui révèle la dimension du partenaire- symptôme. La pression finit par la précipiter en analyse.
En analyse, elle découvre que, finalement, elle va très bien. Elle prospère. Elle jouit au lit. Après l’injure, la baise. Elle enfante. Elle travaille. Et toute la douleur se concentre sur le partenaire injurieux qui apparaît sous la forme que signale Lacan, celle du ravage. Cela la ravage. Et elle arrive à l’analyse dévastée par les dires du partenaire.
Qu’est-ce qui se découvre à l’analyse ? Il se découvre – à l’aide de cette perspective qui s’ouvre lorsqu’on part du principe, tellement salubre, que le sujet est heureux, y compris dans sa douleur – que la parole d’injure est justement le noyau même de sa jouissance, qu’elle a de l’injure jouissance de parole. L’injure est d’ailleurs la parole dernière, celle où le Sinn croche la Bedeutung de façon directe.
Il se découvre qu’il lui faut être stigmatisée pour être. Le stigmate, c’est la cicatrice de la plaie, c’est le corps qui porte les marques de cicatrice. On ne peut pas mieux écrire le stigmate que S de A barré. C’est d’ailleurs dans le stigmate que l’on reconnaissait à l’occasion la marque de Dieu.
Si c’est cet homme-là qu’elle a voulu décrocher et qu’elle garde, c’est dans la mesure même où il lui parle, et sous les espèces de l’injure.
Il la dégrade, sans doute.
Et pourquoi lui faut-il cela ? Parce qu’elle n’est femme qu’à condition d’être ainsi désignée.
Et pourquoi ?
On arrive au terme ultime, au terminus, qui est le père. Le seul rapport sexuel qui ait un sens, c’est le rapport incestueux. Et il se trouve que le père nourrissait un mépris profond pour la féminité, un mépris d’origine religieuse. C’est bien dans ce rapport à son Dieu que s’était pour lui développé une méfiance, une haine à l’endroit de la féminité, qui n’avait pas échappé à la fille. Le couple infernal commémorait le symptôme du père. Le sujet jouissait par son partenaire de la stigmatisation paternelle.
On voit ici que l’Autre de la parole est dans le coup. Certainement. Dans le coup de la jouissance, puisqu’il est là essentiel que le partenaire parle. Mais ici, ce n’est pas l’Autre de la vérité qui est en fonction, ni l’Autre de la bonne foi, mais l’Autre de l’injure. Le sujet se trouve accordé à l’Autre par ce qui est le symptôme de l’Autre. Et elle y satisfait son symptôme à elle. S’il y a rapport, il s’établit ici au niveau symptomatique. Et, dans ce couple, chacun y entre en tant que symptôme.
Le bon usage du symptôme
Cet abord du symptôme, que j’essaie à travers des exemples et un parcours rapide de l’œuvre de Lacan, touche évidemment à l’idée que l’on peut se faire de la fin de l’analyse.
Depuis plusieurs années, on conceptualise la fin de l’analyse à partir de la traversée du fantasme. Le fantasme est là conçu comme un voile qu’il faut lever ou déchirer ou traverser pour atteindre un réel, à l’occasion noté petit a. Cette rencontre aurait valeur de réveil et, certainement, réordonnerait après coup, de façon définitive, les occurrences de la vie du sujet, et ferait apparaître ses tourments antérieurs comme plus ou moins illusoires.
On est donc conduit à opposer, dans cette perspective, la levée du symptôme, qui serait d’ordre thérapeutique, à la traversée du fantasme qui, elle, ouvre un au-delà, et permet un accès au réel, qui est vraiment ce qui est qualifié de passe, avec un changement de niveau. Je crois avoir révélé cette thématique dans toute son intensité, thématique qui est chez Lacan et l’inspire indiscutablement.
C’est aussi bien une thématique classique, celle du sujet vivant dans l’illusion, qui accède diversement, à partir d’une expérience fondamentale, à la vérité, au réel, etc., dans un affect de réveil.
L’éveil est un terme que l’on trouve dans les Sagesses orientales. On découvre que l’on vit dans l’illusion, sous le voile de Maya, et on peut le traverser vers le réveil. Dans la thématique de la traversée du fantasme, on a toutes les harmoniques de cette tradition, qui est présente aussi bien chez Pythagore, Platon, et même peut-être Spinoza.
Mais du point de vue du symptôme, ou du sinthome, comme dit Lacan, la question n’est pas celle de l’illusion, ni celle du réveil au réel ou à la vérité du réel. Du point de vue du symptôme, le sujet est heureux. Il est heureux dans la douleur comme il est heureux dans le plaisir. Il est heureux dans l’illusion comme il est heureux dans la vérité. La pulsion ne connaît pas toutes ces histoires-là. Comme dit Lacan, « tout heur lui est bon », au sujet, pour ce qui le maintient, soit pour qu’il se répète.
Autrement dit, ce qui ne change pas, c’est la pulsion. Il n’y a pas de traversée de la pulsion, pas d’au-delà de la pulsion. J’ai déjà dit jadis qu’il n’y avait pas de traversée du transfert. Certes, il y a l’établissement d’un autre rapport subjectif avec pulsion et transfert, par exemple, un rapport nettoyé de l’Idéal. Si l’on se fie à l’opposition entre le I de l’Idéal et le petit a de la jouissance, le sujet de la fin de l’analyse se trouvera en effet plus proche de la pulsion. C’est ce que Lacan appelle le solde cynique de l’analyse – cynisme est là à entendre dans sa valeur d’anti- sublimation.
Cette perspective n’ouvre pas vers une traversée, mais, plus modestement, à ce que Lacan appelle lui-même, dans la partie ultime de son enseignement, « savoir y faire avec le symptôme ». Ce n’est pas le guérir. Ce n’est pas le laisser derrière soi. C’est au contraire y être vissé, et savoir y faire.
Qu’est-ce qui se déplace entre la thématique de la traversée du fantasme et celle du savoir-y-faire avec le symptôme ? Cela indique en tout cas que cela ne change pas à ce niveau-là. On ne se réveille pas. On arrive seulement à manier autrement ce qui ne change pas.
Le savoir-y-faire renvoie à ce dont le sujet est capable, justement, à l’occasion dans l’ordre imaginaire. On sait y faire, plus ou moins, avec son image. On travaille son image. On vêt son corps. On se maquille. On s’arrange. On fait des régimes. On se bichonne. On va au soleil – avant, on se protégeait du soleil. On soigne son image.
Eh bien, la question serait de savoir y faire avec son symptôme avec le même soin que l’on a pour son image. La perspective est celle d’un bon usage du symptôme. C’est très différent de la traversée du fantasme.
La traversée du fantasme est tout de même une expérience de vérité. C’est la notion que les écailles, à un point, vous tombent des yeux, et que votre existence se réordonne d’une visée d’après-coup.
Le bon usage du symptôme n’est pas une expérience de vérité. C’est plutôt de l’ordre, si j’ose dire, de prendre plaisir à sa jouissance, d’être syntone avec sa jouissance. Très inquiétant, sans doute ! Il se dessine ici quelque chose de l’ordre du sans-scrupule. Le scrupule, au sens étymologique, est un petit caillou qui dérange. Dans la chaussure, par exemple. La conscience est de l’ordre de ce petit caillou. Et le bon usage du symptôme met un peu de côté le fameux petit caillou.
La fin de l’analyse, en ce sens, ce n’est pas de ne plus avoir de symptôme – qui est la perspective thérapeutique, mais au contraire d’aimer son symptôme comme on aime son image, et même de l’aimer à la place de son image.
Le savoir-y-faire avec son symptôme
J’ai mis un accent différent de celui que j’avais mis jusqu’ici sur la fin de l’analyse. Je ne l’ai pas fait sans hésitation préalable, ni sans prudence.
Aggiornamento de notre regard clinique
Il nous faut reconnaître que ce qui s’énonce ici n’est pas sans incidence sur la pratique analytique, au moins dans une certaine aire de cette pratique. Nous ne sommes pas seulement dans une position de commentaire de la pratique qu’il y a, mais les accents qui sont mis, voire les novations qui s’esquissent, ont des conséquences sur la pratique analytique. C’est bien fait pour faire reculer d’y toucher et pour ne pas tout dire.
Depuis que j’ai mis l’accent sur le partenaire-symptôme, sur le rapport du sujet au couple, qu’il forme avec un autre, je suis forcé de constater qu’on m’en parle davantage. On m’en parlait déjà avant, bien entendu. C’est pour cela que cet accent m’a paru s’imposer. Mais, de s’en apercevoir, et de le promouvoir, a pour effet de le renforcer, jusqu’à ce qu’on ne puisse pas méconnaître la place que tient la relation au partenaire dans la pratique et dans la clinique, où cette relation n’est pas un complément, une garniture, mais en apparaît plutôt comme le pivot. Il n’est pas exact de dire que l’on parle essentiellement dans l’analyse de papa, maman, sa famille de naissance, son environnement d’enfance. C’est un fait que l’on parle, de façon pressante et parfois prééminente, du rapport au conjoint, ou du rapport à l’absence de conjoint – ce qui, pour ce qui nous occupe, revient au même. Cela fait partie de l’aggiornamento de notre regard clinique que de faire passer cette perspective qui s’impose au premier plan.
Il y a à cela des raisons de civilisation que nous explorons à tâtons. C’est un fait de l’époque où l’Autre n’existe pas. L’Autre n’existant pas, on se récupère sur le partenaire qui, lui, existe, en tout cas que l’on fait exister de toutes les façons possibles.
La ruine de l’Idéal et la prévalence de l’objet plus-de-jouir, dans le mode de jouissance contemporain tend à ce phénomène qui a été abordé de beaucoup de façons dans d’autres perspectives que la nôtre : la dissolution des communautés, de la famille élargie, des solidarités professionnelles ; voire même, pour employer un mot glorieux du peuple, nous introduit à un phénomène qui va se généralisant de déracinement.
On observe en même temps le surgissement de communautés recomposées sur les nouvelles bases qu’impose le régime nouveau de l’Autre, des communautés recomposées de nouvelles familles, de sectes, d’appartenances associatives, dont l’importance dans l’existence est bien plus grande que par le passé ; et un tissu qui se trame, de façon nouvelle, de solidarités multiples, que d’ailleurs les états tentent d’exploiter, et ils doivent se situer par rapport à ce tissu renouvelé de solidarités. Les états qui sont progressivement soupçonnés de n’être rien qu’une communauté comme une autre aux mains de ce qu’on appelle, aussi bien aux États-Unis qu’en France, la classe politique où l’on ne voit finalement qu’une communauté spéciale ayant ses intérêts particuliers.
Dans cette recomposition communautaire, exigée par le déracinement qui gagne, sans doute le couple est-il la communauté fondamentale. Au moins, la forme du couple est subjectivement essentielle.
Cette forme du couple est d’ailleurs mise en évidence dans la psychanalyse. L’analysant vient faire couple, pour un dialogue des plus spécial, avec l’analyste. On doit bien constater que le discours psychanalytique passe par la formation d’un couple d’artifice. Cette expression même de couple d’artifice ne vaudrait vraiment que si nous avions la notion d’un couple naturel, qui ne serait pas d’artifice. Et c’est bien ce qui est en question. Freud a appelé le liant de ce couple du terme de transfert.
Ce couple analytique est certes dissymétrique. Ses éléments ne sont pas équivalents. Même si le fait que ce soit un couple conduit à vouloir qu’un contre-transfert réponde au transfert, dans certaines perspectives. Ce couple dissymétrique peut être conçu comme libidinal, lorsqu’on voit essentiellement dans l’analyste un objet investi, attirant à lui la libido.
On sait que Lacan s’est refusé à concevoir le couple analytique comme couple libidinal. Il s’y est refusé par le préjugé, dont il est allé chercher la justification chez Freud, que la libido était une fonction essentiellement narcissique illustrée par le couple spéculaire a-a’. Il a considéré que ce contenu-là de la forme couple ne convenait pas au couple analytique et il lui a opposé le couple intersubjectif qui est fondé sur la communication.

C’est un couple qui pivote sur la fonction dite du grand Autre comme auditeur, mais aussi bien, par un renversement émetteur, dans tous les cas interprète, maître de vérité ; et le lien entre les deux est le message, l’adresse. L’Autre majuscule, en même temps que maître de vérité, est maître de reconnaissance du sujet. C’est de là que Lacan a tenté de faire retour sur le couple libidinal.
Le couple intersubjectif, où il s’agit de communiquer, où il s’agit de dire la vérité de ce qu’énonce le sujet, est un couple très intellectuel, un couple passionné par la vérité, par la recherche de la vérité de ce qu’est le sujet. Cela se différencie en effet de ce qu’est le couple libidinal. Une fois qu’il a séparé ces deux registres, la question de Lacan est devenue : comment rendre compte du couple libidinal à partir du couple subjectif? Comment rendre compte de l’amour et du désir à partir de la communication? Il n’y a pas donné qu’une réponse. Mais ses réponses ont toutes nécessité l’introduction de ce que j’appellerai des termes Janus.
Il a d’abord répondu à la question « comment rendre compte de l’amour et du désir à partir du couple intersubjectif ? » en termes signifiants. C’est sa doctrine du phallus, où la libido est réduite à des phénomènes de signifiant et de signifié, où le partenaire de l’amour et du désir est le phallus. Le phallus est un terme Janus parce qu’il appartient d’un côté au symbolique et de l’autre côté au registre libidinal. C’est donc la réponse en termes du partenaire phallique.
![]() Il a donné un peu plus tard, parfois simultanément, une autre réponse, à l’aide d’un autre terme Janus, l’objet petit a qui, sans doute, n’étant pas un signifiant, est plus proche du registre libidinal que le phallus. Mais tout en n’étant pas un signifiant, Lacan le fait fonctionner dans sa circulation comme un signifiant. Par exemple, dans le schéma des quatre discours, la lettre petit a n’est pas un signifiant mais tourne avec les signifiants et avec le manque de signifiant. L’objet petit a est aussi un terme Janus comme le phallus.
Il a donné un peu plus tard, parfois simultanément, une autre réponse, à l’aide d’un autre terme Janus, l’objet petit a qui, sans doute, n’étant pas un signifiant, est plus proche du registre libidinal que le phallus. Mais tout en n’étant pas un signifiant, Lacan le fait fonctionner dans sa circulation comme un signifiant. Par exemple, dans le schéma des quatre discours, la lettre petit a n’est pas un signifiant mais tourne avec les signifiants et avec le manque de signifiant. L’objet petit a est aussi un terme Janus comme le phallus.
C’est le couple fantasmatique où le partenaire de l’amour et du désir apparaît essentiellement réduit à ce statut d’objet. C’est alors le fantasme qui constitue en quelque sorte, pour Lacan, le couple fondamental du sujet, au point que, très logiquement, pour situer la place de l’analyste, il lui faut en définitive la place repérée par le terme de l’objet petit a.
La doctrine lacanienne classique de la fin de l’analyse s’est concentrée sur ce couple-là. C’est essentiellement ce que Lacan a appareillé sous les espèces de la passe. Lorsqu’il est arrivé à dégager la fonction du couple fantasmatique, il a pensé qu’il pouvait le mettre en appareil destiné à capter, à organiser la fin de l’analyse.
Cette doctrine est devenue classique – soyons exacts parce que j’ai mis l’accent dessus. Au moment où Lacan s’est arrêté d’enseigner et où son École, non seulement a été dissoute, mais a volé en éclats, cela faisait longtemps que la passe était écartée pour ses principaux élèves. La preuve en est qu’à ce moment-là aucun des groupes lacaniens, sinon celui dont je faisais partie, n’a repris à son compte la pratique de la passe, en considérant que l’échec était avéré. D’ailleurs même, pas si à tort. L’enseignement de Lacan semblait avoir fait son deuil de la passe, l’avoir en tout cas minorée.
C’est vrai qu’en 1981-82 j’ai fait ce que j’ai pu pour rétablir la passe comme doctrine et comme fonctionnement, pensant que l’institution qu’il s’agissait de reconstituer sur de nouvelles bases exigeait cet appareil de la passe. Je ne donne ces précisions que parce qu’aujourd’hui où je veux donner un accent différent j’en vois venir qui me crient au contraire : « Mais la passe, mais la passe! » Du calme ! L’histoire est plus complexe. Lacan a proposé l’appareil de la passe en 1967. Il a continué d’enseigner jusqu’à 1980. Il a donné, dans cette trajectoire, des inflexions qu’il vaut la peine de suivre.
Avant la doctrine de la passe, la fin de l’analyse était pour Lacan avant tout située comme un au-delà de l’imaginaire, et donc avant tout située par deux termes appartenant au registre symbolique, deux termes qui ont été successivement la mort et le phallus.
C’est de façon contrariée, contrastée, que Lacan situait la fin de l’analyse par rapport à ces deux termes du registre symbolique. Pour ce qui est du premier, il situait la fin de l’analyse en termes d’assomption. Pour ce qui est du second, en termes de désidentification. Dans un cas comme dans l’autre, le repère essentiel, le lieu de la fin de l’analyse, était, au-delà de l’imaginaire, le symbolique.
En effet, avec la doctrine de la passe, ce qui se dessine c’est que le lieu de la fin de l’analyse est au-delà du symbolique, par une certaine mise au jour du partenaire petit a. Ce rapport-là, Lacan l’a appelé, une fois, pas tellement plus, la traversée du fantasme, dont j’ai fait une sorte de schibboleth, un leitmotiv, en l’opposant à la levée du symptôme et en le situant dans la grande opposition du symptôme et du fantasme. J’ai tellement bien réussi que, lorsque je veux y toucher, ne serait-ce que d’une main légère, c’est une insurrection. – « Miller a touché à la traversée du fantasme » On me réclame la stagnation. Il ne faut surtout pas que je bouge. On veut du père mort. On demande du père, et surtout du père mort.
Je fais tout de même remarquer que la traversée du fantasme met foncièrement l’accent sur la fonction de la vérité, même lorsqu’il semble qu’elle parle du réel. Elle met en tout cas l’accent sur un certain au-delà du savoir sous forme de vérité et s’inscrit dans une dialectique du voile et de la vérité, le fantasme étant considéré comme ce voile qu’il s’agit de lever ou de traverser pour atteindre une certaine vérité du réel. La traversée du fantasme implique quelque chose comme un réveil au réel. Ce n’est pas que ce soit faux, mais ne peut-on pas mettre en question ce qui s’annonce là glorieusement de discontinuité, voire de définitif, simplement au vu des résultats.
Ceux qui sont des passés sont-ils si réveillés ? Ils paraissent aussi bien installés dans un certain confort, un confort sans scrupule. C’est pourquoi, bien que Lacan n’ait dit cela qu’une fois, il me paraît qu’il vaut la peine de déplacer l’accent.
Ce mot de traversée fait traversée du Pont d’Arcole. Il y a de l’héroïsme dans la traversée. Il y a la traversée de l’Atlantique par Lindbergh, la traversée des 10 000, la longue marche chinoise. La traversée mobilise une imagerie d’héroïsme. Ne peut-on, au vu des résultats, simplement ajouter, mettre à côté de la traversée du fantasme, ce que Lacan appelle d’une façon exquise, modeste, le savoir-y-faire avec son symptôme ? – qui est d’un tout autre accent. Cela ne met pas au premier plan la discontinuité entre l’avant et l’après.
Le savoir-y-faire avec son symptôme est une affaire d’à-peu-près. Il y entre du flou, du vague – fuzzy -, comme on appelait certaines logiques des « logiques floues ». Ce n’est pas nécessairement l’opposé de la traversée du fantasme. On pourrait même dire : après la traversée du fantasme, le savoir-y-faire avec son symptôme. Si l’on veut ménager des transitions, ne pas déboussoler la population.
Savoir-faire et savoir-y-faire
Je mettrai là aussi l’accent sur la différence que propose Lacan, délicate, et qu’il ne développe pas, entre savoir-y-faire et savoir-faire. Il le dit une fois dans un Séminaire des dernières années.
Là, il faut construire, parce qu’il ne dit pas pourquoi il les oppose. Voilà ce que j’invente à ce propos.
Le savoir-faire est une technique. Il y a savoir-faire lorsqu’on connaît la chose dont il s’agit, lorsqu’on en a la pratique. D’ailleurs, le savoir-faire, sans être élevé au rang de la théorie, cela s’enseigne. Aux États-Unis, on trouve dans les librairies des manuels de How do… ? Comment faire avec… ? Le savoir- faire avec… tout. Comment conduire sa voiture ? son mariage ? Comment faire de la gymnastique ? la cuisine française ? Etc. Le savoir-faire est une technique pour laquelle il y a une place lorsqu’on connaît la chose dont il s’agit et on peut définir des règles reproductibles, par là même enseignables.
Le savoir-y-faire a place lorsque la chose dont il s’agit échappe, lorsqu’elle conserve toujours quelque chose d’imprévisible. Tout ce que l’on peut faire alors, c’est l’amadouer, en restant sur ses gardes.
Dans le savoir-faire, la chose est domestiquée, soumise, tandis que dans le savoir-y-faire, la chose reste sauvage, indomptée. C’est pourquoi, du côté du savoir-faire, il y a de l’universel. Lorsqu’il y a du singulier, il n’y a que savoir-y-faire. Dans le savoir-faire, on connaît la chose. Pas de surprise ! Tandis que dans le savoir-y-faire, admettons que l’on sait prendre la chose, mais avec précaution. On ne la connaît pas. On est toujours à devoir s’attendre au pire.
C’est là que j’introduis un petit bout de Lacan. Dans le savoir-y-faire, on ne prend pas la chose en concept. Cette indication menue me paraît congruente avec ce que j’ai développé. Dans le savoir-faire, on a domestiqué la chose par un concept, tandis que, dans le savoir-y-faire, la chose reste extérieure à toute capture conceptuelle possible. Du coup, non seulement on n’est pas dans la théorie, mais on n’est même pas vraiment dans le savoir. Le savoir-y-faire n’est pas un savoir, au sens du savoir articulé. C’est un connaître, au sens de savoir se débrouiller avec. C’est une notion qui, dans son flou et son approximation, me paraît essentielle de l’ultime Lacan – savoir se débrouiller avec.
Nous sommes là au niveau de l’usage, de l’us – vieux mot français que vous retrouvez dans l’expression « les us et coutumes », qui vient directement du latin usus et de uti, se servir de.
Le niveau de l’usage est, pour le dernier Lacan, un niveau essentiel. Nous l’avons déjà abordé, ne serait-ce que par la disjonction du signifiant et du signifié. Le dernier enseignement de Lacan met en effet l’accent, contrairement à « L’instance de la lettre », sur le fait qu’il n’y a aucune espèce de lien entre signifiant et signifié, et qu’il y a seulement, entre signifiant et signifié, un dépôt, une cristallisation, qui vient de l’usage que l’on fait des mots. La seule chose qui est nécessaire pour qu’il y ait une langue, c’est que le mot ait un usage, dit-il, cristallisé par le brassage.
Cet usage, c’est qu’un certain nombre de gens s’en servent, « on ne sait pas trop pourquoi », dit Lacan. Ils s’en servent et, petit à petit, le mot se détermine par l’usage qu’on en fait.
Le concept d’usage est essentiel à ce dernier enseignement de Lacan, précisément en tant que distinct du niveau du système, le niveau saussurien du système qui a inspiré Lacan au départ. A système, s’oppose usage. A la loi diacritique du système fixé dans la coupe synchronique qu’on en fait, pour le déterminer, s’opposent les à-peu-près, les convenances, les bienséances et les pataquès de l’usage des mots, de la pratique. Il y a là en effet, essentielle, une disjonction entre théorie et pratique. Cette disjonction qui déjà s’amorce par le savoir-faire – le savoir-faire est déjà une pratique codifiée distincte de la théorie – éclate dans le savoir-y-faire. Là, pas de théorie, et une pratique qui va son chemin toute seule, comme le chat de Kipling.
Tant qu’il y avait l’Autre, trésor du signifiant, on n’avait pas besoin de l’usage. On pouvait dire : « On se réfère à cet Autre pour savoir ce que les mots veulent dire. » Et puis, lorsque les mots sont en fonction et qu’évidemment ce n’est pas exactement comme dans le dictionnaire, on avait recours au maître de vérité, à celui qui dit, qui ponctue, et qui choisit ce que cela veut dire.
Mais lorsque l’Autre n’existe pas, lorsque vous n’élevez pas la contingence du dictionnaire au statut de norme absolue, lorsque vous croyez plus ou moins au maître de vérité, et plutôt moins que plus, lorsque c’est plutôt de l’ordre « lui il dit ça et moi je dis autre chose », lorsque l’Autre n’existe pas, alors il n’y a plus que l’usage. Le concept d’usage s’impose précisément de ce que l’Autre n’existe pas. La promotion de l’usage se fait là où le savoir défaille, où l’esprit de système est impuissant, et là aussi bien où la vérité, avec son cortège de maîtres plus ou moins à la manque, ne s’y retrouve pas.
C’est bien pourquoi il y a une corrélation essentielle entre le concept de l’usage et le réel, dans sa définition radicale que Lacan a proposée, presque en tremblant : « Peut-être est-ce mon symptôme à moi. » Le réel, dans sa définition radicale, n’a pas de loi, n’a pas de sens, n’apparaît que par des bouts, ce qui veut dire qu’il est tout à fait rebelle à la notion même de système. C’est pourquoi le rapport au réel, même le bon rapport au réel, est marqué, qualifié par le terme d’usage.
La meilleure preuve – Lacan ne cesse pas d’en parler dans son dernier enseignement –, c’est qu’on s’embrouille toujours. On met toujours à côté. L’homme s’embrouille avec le réel. C’est par là qu’on en approche la définition la plus probante.
Il s’embrouille aussi avec le symbolique. C’est bien parce que l’homme s’embrouille avec le symbolique qu’il y a quelque chose de réel dans le symbolique. C’est lorsqu’on n’arrive plus à maîtriser le symbolique, mais qu’on tâtonne, qu’on essaie d’y faire, c’est bien ce qui est la marque qu’il y a du réel dans le symbolique.
L’homme s’embrouille aussi bien avec l’imaginaire, et c’est la marque de ce qu’il y a de réel dans l’imaginaire. C’est pourquoi Lacan qualifie la position native de l’homme comme celle de la débilité mentale. C’est cohérent avec cet ensemble de termes l’usage, le réel, le s’embrouiller, et le statut de débilité mentale, qui tient à ce que le sujet a de foncièrement désaccordé d’emblée.
D’où la question est de s’en débrouiller, d’arriver à s’en tirer, mais dans un esprit qui est là plus empirique que systématique. C’est là que Lacan se réfère au bien-dire. Le bien-dire n’est pas la démonstration. Le bien-dire est le contraire du mathème. Le bien-dire veut dire qu’un sujet arrive finalement à se débrouiller du réel avec du signifiant. Mais pas plus que de se débrouiller. C’est au point que Lacan, dans une définition éclatante, propose du réel qu’il se trouve dans les embrouilles du vrai.
C’est de cela qu’il est question, d’embrouille, de débrouillardise, type Bibi Fricotin, des embrouillaminis, des imbroglios, de la façon que l’on a de s’emmêler avec ce dont on se mêle. L’objet à faire sentir que l’essentiel de la condition humaine est l’embrouille, l’objet que Lacan a mis au tableau pendant des années, c’est le nœud, qui est par excellence l’embrouille.
Le repère de Lacan, avant, c’était la science, c’est-à-dire pas du tout le bien dire, mais la démonstration, la réduction du réel par le signifiant. Ensuite, au moment de son dernier enseignement, c’est l’art, dans sa différence avec la science, l’art qui est un savoir-y-faire, voire même savoir-faire, mais au-delà des prescriptions du symbolique.
Le symptôme est avant tout, dans cette perspective, un fait d’embrouille. Il y a symptôme lorsque le nœud parfait rate, lorsque le nœud s’embrouille, lorsqu’il y a, comme disait Lacan, lapsus du nœud. Mais, en même temps, ce symptôme fait d’embrouille est aussi point de capiton et en particulier point de capiton du couple. Ce qui fait qu’à cet égard le symptôme aussi y est un terme Janus. Le symptôme, par une de ses faces, est ce qui ne va pas, mais, par son autre face, celle que Lacan avait dénommée sinthome, en ayant recours à son étymologie, il est le seul lieu où, pour l’homme qui s’embrouille, finalement, ça va.